Source : The Intercept, James Risen, 03-01-2018
Ma vie de journaliste pour le New York Times dans l’ombre de la guerre contre la terreur
James Risen
3 Janvier 2018
J’étais assis dans la salle presque vide du restaurant de l’hôtel Westin à Alexandria, dans l’état de Virginie, me préparant à une confrontation avec le gouvernement fédéral que j’avais essayé d’éviter pendant plus de sept ans. L’administration Obama me demandait de révéler les sources confidentielles sur lesquelles je m’étais appuyé pour la rédaction du chapitre décrivant une opération sabotée de la CIA dans mon livre State of War publié en 2006. J’avais également rédigé un article sur cette opération de la CIA pour le New York Times mais la rédaction du journal n’a pas publié l’histoire à la demande du gouvernement.
1. LE MARCHÉ AUX SECRETS
Serrés les uns contre les autres dans le vent glacial, mes avocats et moi étions sur le point de passer les portes du palais de justice quand deux nouveaux photographes commencèrent à nous prendre en photo frénétiquement. En temps que journaliste, j’avais assisté des dizaines de fois, en regardant de loin avec amusement, à cette scène classique où des photographes et des équipes de télévision faisaient leur travail. Je n’aurais jamais imaginé être un jour le coupable faisant face au ronronnement des caméras.
Alors que je dépassais les photographes et entrais dans le palais de justice ce matin de Janvier 2015, j’aperçus un groupe de reporters, dont certains que je connaissais personnellement. Ils étaient là pour couvrir mon affaire, m’attendant et me regardant. Je me sentais seul et isolé.
Mes avocats et moi pénétrèrent dans une salle de conférence exiguë située juste à côté de la salle d’audience de la juge de district des États-Unis Leonie Brinkema, où nous attendîmes qu’elle commence l’audience préliminaire qui déterminerait mon destin. Mes avocats avaient travaillé avec moi sur ce dossier pendant tellement d’années qu’ils se sentaient maintenant plus des amis que des avocats. Nous parlions souvent avec humour noir de ce qu’il adviendrait de moi quand je serai incarcéré. Mais ils avaient fait leur maximum pour s’assurer que ça n’arrive pas et avaient même réussi à me garder hors d’une salle d’audience et éloigné de tout interrogatoire par le procureur fédéral.
Jusqu’à présent.
Mon affaire faisait partie d’un plus gros large éventail de mesures répressives à l’encontre des reporters et lanceurs d’alertes qui avait débuté au cours de la présidence de George W. Bush et qui se poursuivait de façon beaucoup plus agressive sous l’administration Obama, qui avaient déjà poursuivi plus d’affaires de fuites que l’ensemble des administrations précédentes réunies. Les fonctionnaires d’Obama semblaient déterminés à utiliser les enquêtes criminelles sur les fuites pour restreindre la production de rapports sur les questions de sécurité nationale. Mais ces mesures répressives ne s’appliquaient qu’aux dissidents communs ; les hauts responsables pris dans les enquêtes pour fuites, comme l’ancien directeur de la CIA David Petraeus, étaient toujours traités avec des pincettes.
Au début, j’avais gagné devant les tribunaux, à la surprise de nombreux juristes. Au tribunal de première instance du district est de l’État de Virginie, Brinkema s’était rangée à mes côtés quand le gouvernement m’avait, à de multiples reprises, assigné à comparaître pour témoigner devant le grand jury. Elle avait encore rendu justice en ma faveur lorsqu’elle avait annulé mon assignation à comparaître dans l’affaire Jeffrey Sterling, un ancien agent de la CIA accusé par le gouvernement d’être une des sources des fuites pour l’article sur l’opération malheureuse de la CIA. Lors de ses jugements, Brinkema avait déterminé qu’il existait un « privilège du journaliste » – au moins limité – dans le 1er Amendement conférant aux journalistes le droit de protéger leurs sources, de la même façon que les communications clients et patients avec leurs avocats et médecins peuvent être protégées.
Mais l’administration Obama fit appel de son jugement de 2011 qui annulait mon assignation à comparaître, et en 2013, la 4ème Cour d’appel, dans une décision non unanime, se rangeait du côté de l’administration, jugeant que le privilège du journaliste n’existait pas. En 2014, la Cour Suprême refusa de considérer ma demande d’appel, permettant le maintien de la décision de la 4ème Cour d’appel. Il n’y avait maintenant plus de recours légaux pour empêcher la justice de me forcer soit à révéler mes sources, soit à être emprisonné pour entrave à la justice.
Mais même si je perdais devant les tribunaux, je gagnais du terrain dans l’opinion publique. Ma décision d’aller devant la Cour Suprême avait attiré l’attention des classes politique et médiatique du pays. Au lieu d’ignorer mon affaire, comme ils l’avaient fait pendant des années, les médias nationaux la présentaient à présent comme un débat constitutionnel majeur autour de la liberté d’expression.
Ce matin-là, à Alexandria, mes avocats et moi apprenions que le procureur était irrité par mon style d’écriture. Dans State or War : The Secret History of the CIA and the Bush Administration, je n’avais pas donné de noms dans de nombreux passages. Je n’avais pas explicitement dit d’où provenaient mes informations et je n’avais pas indiqué quelles informations étaient classées secrètes et lesquelles ne l’étaient pas. C’était une décision volontaire de ma part ; je ne voulais pas interrompre le flux narratif du livre avec des phrases détaillant comment j’avais eu connaissance de chaque fait et je ne voulais pas dire explicitement la façon dont j’avais obtenu des informations si sensibles. Si le procureur ne pouvait citer de passages spécifiques pour prouver que mes informations reposaient sur des sources confidentielles qui m’avaient divulgué des informations classées secrètes, leurs poursuites criminelles contre Sterling pourraient ne plus tenir.
Quand je pénétrais dans la cour d’audience ce matin-là, je pensais que le procureur pourrait me demander d’identifier publiquement certains passages du livre reposant sur des informations classées secrètes et des sources confidentielles. Si je ne m’exécutais pas, il pourrait demander au juge de m’inculper et de m’incarcérer.
J’étais inquiet, mais j’étais confiant que l’audience, d’une façon ou d’une autre, viendrait achever la longue et étrange trajectoire que je vivais en tant que journaliste d’investigation spécialisé dans les questions de sécurité nationale depuis ces 20 dernières années. Alors que je m’avançais à la barre, je pensais à la façon dont j’avais fini ici, combien la liberté de la presse avait reculé et à la façon dont le journalisme relatif à la sécurité nationale avait changé dans l’ère post-11 Septembre.

D’en haut à gauche à en bas à droite : Aldrich Ames, John I. Millis, John Deutch, Wen Ho Lee. Photo: AP, Getty images
Il n’ y a pas de salle de presse au quartier général de la CIA, comme à la Maison-Blanche. L’agence ne distribue pas de laissez-passer de presse qui permettent aux journalistes de circuler dans les couloirs, comme ils le font au Pentagone. Elle n’organise pas régulièrement des points de presse, comme le Département d’État le fait sous la plupart des administrations. Le seul avantage que les journalistes couvrant la CIA ont, c’est le temps. Comparativement aux autres secteurs importants de Washington, la CIA produit relativement peu de sujets quotidiennement. Vous avez plus de temps pour creuser, plus de temps pour rencontrer les gens et développer des sources.
J’ai commencé à couvrir la CIA en 1995. La guerre froide était terminée, la CIA réduisait ses effectifs et l’officier de la CIA Aldrich Ames venait d’être démasqué en tant qu’espion russe. Toute une génération de hauts fonctionnaires de la CIA quittait Langley. Beaucoup voulaient parler.
J’étais le premier journaliste que beaucoup d’entre eux avaient rencontré. Lorsqu’ils sont sortis de leur vie insulaire à la CIA, ils avaient peu de notions sur les informations qui seraient jugées dignes d’intérêt. J’ai donc décidé de faire preuve de plus de patience avec les sources que jamais auparavant. J’ai dû apprendre à écouter et à les laisser parler de ce qui les intéressait. Ils avaient des histoires fascinantes à raconter.
En plus de leur expérience des opérations d’espionnage, bon nombre d’entre eux avaient participé à des réunions présidentielles au sommet, à des négociations de traités et à d’autres conférences internationales officielles. Je me suis rendu compte que ces anciens officiers de la CIA avaient été dans les coulisses de certains des événements les plus historiques des dernières décennies et qu’ils avaient donc une perspective unique et cachée sur ce qui s’était passé dans les coulisses de la politique étrangère américaine. J’ai commencé à penser à ces officiers de la CIA comme aux personnages du titre de la pièce de Tom Stoppard Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, dans laquelle Stoppard ré-imagine « Hamlet » du point de vue de deux personnages mineurs qui regardent avec fatalisme la pièce de Shakespeare depuis les coulisses.
Alors que je m’intéressais à la CIA pour le Los Angeles Times et plus tard pour le New York Times, je découvris qu’écouter patiemment mes sources se révélait très utile de façon inattendue. Au cours d’un entretien, une source qui blablatait sur une bataille bureaucratique mineure au sein de la CIA mentionna brièvement comment Bill Clinton, alors président, avait secrètement donné son feu vert à l’Iran pour l’envoi secret d’armes aux musulmans bosniaques pendant la guerre des Balkans. L’homme avait déjà repris son discours sur les disputes bureaucratiques quand j’ai réalisé ce qu’il venait de dire et que je l’interrompais pour lui demander de revenir sur ses propos sur l’Iran. Ceci m’amena à écrire une série d’articles qui obligea la chambre des députés à créer un comité restreint spécial chargé d’enquêter sur le réseau dissimulé de distribution d’armes entre l’Iran et la Bosnie. Une autre source me surprit en m’offrant une copie du rapport secret de la CIA décrivant sa propre implication dans le coup d’état iranien de 1953. Jusqu’alors, la CIA avait maintenu que nombre de ses documents internes relatifs à ce coup d’état avaient été perdus ou détruits depuis longtemps.
Mais un incident m’amena à me demander si je devais continuer mon travail de journaliste pour les questions de sécurité nationale. En 2000, John Millis, un ancien membre de la CIA devenu directeur du personnel du House Intelligence Committee, me fit venir dans son petit bureau de Capitol Hill. Après avoir refermé la porte, il sortit un dossier classé secret par l’inspecteur général de la CIA et le lu à voix haute, doucement, alors que j’étais assis à côté de lui. Il répéta certains passages quand je le lui demandai pour me permettre de noter mot pour mot ce qui était écrit dans le rapport. Le rapport concluait que les hauts-fonctionnaires de la CIA avaient entravé une enquête interne apportant la preuve que l’ancien directeur de la CIA John Deutch avait mal géré un large volume de documents classés secrets en les téléchargeant sur son ordinateur personnel à son domicile.
L’histoire était explosive et elle énerva les hauts-fonctionnaires de la CIA.
Plusieurs mois plus tard, Millis s’est suicidé. Son décès me choqua profondément. Je ne pouvais imaginer que mon article ait pu jouer un rôle dans son décès mais en voyant la foule d’actuels et anciens hauts-fonctionnaires de la CIA se déverser dans cette église de banlieue de l’État de Virginie où avaient lieu ses funérailles, je me suis demandé si je n’étais pas pris dans un jeu qui se révélait mortel. (Je n’ai jamais révélé avant que Millis était ma source pour l’affaire Deutch mais sa mort il y a plus de 17 ans me pousse à croire qu’il n’y a plus aucun intérêt à continuer à cacher son identité. Dans un entretien pour cet article, la veuve de Millis, Linda Millis convint qu’il n’y avait plus de raison de cacher le rôle de son mari comme source, ajoutant : « Je ne crois pas qu’il y ait de preuve que [faire fuiter le rapport Deutch] soit lié à la mort de John. »)
Une autre leçon importante bien que douloureuse vient de mon reportage sur l’affaire de Wen Ho Lee, un scientifique Sino-américain travaillant au Los Alamos National Laboratory, qui fut suspecté en 1999 par le gouvernement d’espionnage pour le compte de la Chine. Après que le dossier monté contre lui pour espionnage par le gouvernement se fut effondré, j’ai été fortement critiqué – y compris dans un éditorial du New York Times – pour avoir rédigé des articles manquant de mises en garde quant aux défauts et aux zones d’ombres présents dans le dossier monté par le gouvernement. L’éditorial mentionnait que nous « aurions dû creuser plus profondément pour révéler les faiblesses du dossier du FBI contre le Dr. Lee », et que « au lieu de prendre un ton journalistique détaché d’avec nos sources, nous avions parfois employé un langage qui laissait transparaître l’inquiétude contenue dans les rapports officiels et qui nous était apparue lors de nos conversations avec les enquêteurs, les membres du Congrès et les hauts-fonctionnaires informés de l’affaire. »
Avec le recul, je crois que les critiques étaient fondées.
Cette expérience amère m’a presque décidé à quitter le Times. À la place, je décidai de rester. À la fin, ça m’a rendu encore plus sceptique vis-à-vis du gouvernement.

Le directeur de la CIA George Tenet dans les locaux du FBI à Washington le 20 Février 2001. Photo : Rick Bowmer/AP
Réussir en temps que journaliste spécialiste de la CIA signifiait inévitablement trouver des informations sur les secrets du gouvernement, et ça signifiait plonger la tête la première dans la partie cachée de Washington, qui possède sa propre dynamique étrange.
Je découvris qu’il y avait en réalité un marché aux secrets à Washington, dans lequel les représentants de la Maison Blanche et d’autres bureaucrates actuels et passés, des entrepreneurs, des membres du Congrès, leurs employés et des journalistes se livraient tous au commerce d’informations. Ce marché noir officieux aidait à maintenir sans heurt le fonctionnement de l’appareil de sécurité nationale, limitant les mauvaises surprises pour toutes les personnes impliquées. La révélation de l’existence de cette sous-culture secrète permettant à un journaliste d’apercevoir le côté sombre du gouvernement était bouleversant. Ça donnait l’impression d’être dans Matrix.
Quand il était révélé que vous vous intéressiez à ce monde caché, des sources vous apparaissaient parfois de façon mystérieuse. Une fois, je reçus un appel anonyme de quelqu’un détenant des informations hautement sensibles qui avait lu d’autres articles que j’avais écrits. Les informations de cette nouvelle source étaient très détaillées et de grande valeur mais la personne refusa de révéler son identité et dit simplement qu’elle rappellerait. La source rappela quelques jours plus tard avec encore plus d’informations et après plusieurs appels, j’avais réussi à la convaincre d’appeler à une heure précise pour me permettre d’être prêt à lui parler. Pendant les quelques mois qui ont suivi, elle appela une fois par semaine, toujours à la même heure et toujours avec de nouvelles informations. Parce que je ne savais pas qui était la source, je devais être prudent avec ces informations et ne jamais les utiliser dans mes articles à moins de pouvoir les recouper avec celles provenant d’autres sources. Mais toutes les informations que cette source me livra se révélèrent justes. Puis après quelques mois, elle arrêta brutalement d’appeler. Je n’entendis plus jamais parler d’elle et je ne connus jamais son identité.
Un haut-fonctionnaire de la CIA me dit une fois que sa manière empirique pour décider si une opération secrète devait être approuvée était, « À quoi est-ce que ça va ressembler en une du New York Times ? »
La divulgation d’informations confidentielles à la presse était généralement tolérée comme une des choses de la vie dans cette sous-culture secrète. Les médias jouaient le rôle de soupape de sécurité, permettant aux intéressés de vider leur sac en laissant fuiter les informations. Les élus les plus intelligents réalisèrent que faire fuiter des informations dans la presse les aidaient souvent, apportant un regard nouveau aux vieux débats internes. Et la présence de la presse, attendant ces fuites, apportait de la discipline au système. Un haut-fonctionnaire de la CIA me dit une fois que sa manière empirique de décider si une opération secrète devait être approuvée était, « À quoi est-ce que ça va ressembler en une du New York Times ? » Si l’image renvoyée est mauvaise, ne le fais pas. Bien entendu, sa règle empirique était souvent ignorée.
Pendant des décennies, les élus de Washington ne firent presque rien pour mettre fin aux fuites. La CIA ou n’importe quelle autre agence feignait d’être offensée après la publication d’un article qu’elle n’approuvait pas. Les représentants de ces agences ouvraient des enquêtes pour identifier la source des fuites mais remplissaient seulement la paperasse avant d’abandonner chaque enquête. C’était une mascarade que les représentants du gouvernement et les journalistes comprenaient.
Dans le cadre de mon affaire juridique, mes avocats déposèrent des demandes invoquant le Freedom of Information Act [NdT : loi sur l’accès à l’information] auprès de différentes agences du gouvernement pour obtenir les documents que ces agences détenaient sur moi. Toutes les agences refusèrent de fournir les documents liés à mon affaire de fuites mais à la fin, le FBI commença à nous remettre tout un tas de documents relatifs à de vieilles enquêtes pour fuites qui avaient été menées bien des années auparavant à la suite d’autres articles que j’avais écrits. J’étais stupéfait d’apprendre leur existence.
Les documents révélaient que le FBI donnait des noms de code à ses enquêtes pour fuites. Une liasse de documents indiquait le nom de « BRAIN-STORM » donné à une enquête ; une autre, nommée « SERIOUS MONEY » s’intéressait à un article que j’avais publié en 2003 sur la façon dont le régime irakien de Saddam Hussein avait essayé de conclure à la dernière minute un accord secret avec l’administration Bush pour éviter la guerre. Encore une fois, le gouvernement avait clôturé toutes ces enquêtes pour fuites sans prendre de mesures contre mes sources ou moi, du moins pour autant que je sache.
Après le 11 Septembre, les représentants du gouvernement avaient une envie limitée de poursuivre agressivement les affaires de fuites et les fonctionnaires du Département de la Justice et du FBI s’intéressaient peu à ces affaires de fuites. Ils savaient que c’étaient des affaires sans-issue. Une note du FBI à propos de l’enquête dite « BRAIN STORM » et datée du 19 Juin 2003 montre qu’elle partagea le devenir de virtuellement toutes les enquêtes de cette époque. Selon cette note, l’antenne du FBI de Washington « avaient couvert toutes les pistes logiques et aucun suspect fiable n’a été identifié ». « Dans ce contexte, le WFO [NdT : Washington’s Field Office, le bureau de Washington du FBI] renvoie cette affaire au FBIHQ [NdT : FBI Headquaters, le quartier général du FBI] pour des analyses additionnelles et/ou présenter cette affaire au DOJ [NdT : Departement of Justice, Département de la Justice] pour sa clôture. »
Une des raisons pour laquelle les élus ne voulaient pas mener d’enquêtes agressives sur les fuites résidait dans le fait qu’ils négociaient souvent discrètement avec la presse dans le but de mettre un terme à publication d’articles sur des questions sensibles de sécurité nationale. Les représentants du gouvernement semblaient comprendre qu’une approche agressive de la question des fuites pourrait mener à la fin de cet accord tacite.
A cette époque, j’acceptais généralement ces négociations. Par exemple, environ un an avant le 11 Septembre, j’appris que la CIA avait envoyé des agents en Afghanistan pour rencontrer Ahmed Shah Massoud, le chef de file de l’Alliance rebelle du nord qui combattait le gouvernement taliban. Les agents de la CIA avaient été envoyés pour convaincre Massoud d’aider les américains dans leur poursuite d’Oussama ben Laden qui vivait alors en Afghanistan sour la protection du régime taliban.
Quand j’ai demandé un commentaire à la CIA, le directeur de l’époque George Tenet me rappela personnellement pour me demander de ne pas publier cette histoire. Il me dit que sa révélation mettrait en danger la sécurité des agents de la CIA présents en Afghanistan. J’acceptai.
J’écrivis finalement cette histoire après le 11 Septembre mais je me demandais si ne pas la publier avant les attaques de New York et de Washington n’avait pas été une erreur. Des enquêtes indépendantes sur le 11 Septembre conclurent plus tard que les efforts de la CIA pour neutraliser ben Laden avant les attaques avaient été peu enthousiastes. Si j’avais rapporté cette histoire avant le 11 Septembre, ça aurait irrité la CIA mais ça aurait pu ouvrir un débat public sur les moyens déployés par les États-Unis pour capturer ou tuer ben Laden. Ce débat public aurait pu forcer la CIA à prendre plus au sérieux ses efforts pour attraper ben Laden.
L’expérience que j’ai acquise grâce à cette histoire et plus tard grâce à d’autres m’a rendu beaucoup moins disposé à accepter les requêtes du gouvernement pour reporter à plus tard ou annuler la publication de certains articles. Ce qui, en fin de compte, m’amena à l’affrontement avec les éditeurs du New York Times qui étaient encore plutôt disposés à coopérer avec le gouvernement.

Le président Georges W. Bush s’adresse à la nation depuis le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, D.C. le 19 mars 2003, pour annoncer les frappes aériennes de l’armée américaine en Irak. Photo : Alex Wong/Getty Images
2. VOUS FOURNISSEZ LES PHOTOS, JE ME CHARGE DE LA GUERRE
Après les attaques du 11 septembre 2001, l’administration Bush commença à demander plus fréquemment à la presse de supprimer les articles. Ils l’ont fait si souvent que je fus convaincu que l’administration invoquait la sécurité nationale pour faire taire des histoires qui n’étaient que politiquement embarrassantes. À la fin de 2002, par exemple, j’appelai la CIA pour qu’elle commente un article sur l’existence d’une prison secrète de la CIA en Thaïlande qui venait d’être créée pour recevoir des détenus d’Al-Qaïda, y compris Abu Zubaydah. En réponse, les responsables de l’administration Bush appelèrent le Times et firent supprimer l’article par le journal. Je n’étais pas d’accord avec la décision du journal parce que je croyais que la Maison-Blanche essayait simplement de dissimuler le fait que la CIA avait commencé à mettre en place des prisons secrètes. Je rapportai finalement l’information un an plus tard. (En 2014, le rapport du Comité sénatorial du renseignement sur le programme de torture de la CIA fournit un nouvel éclairage sur les conséquences de l’histoire censurée sur la Thaïlande . « En novembre 2002, après que la CIA eut appris qu’un grand journal américain savait qu’Abu Zubaydah était dans le pays [expurgé], des hauts fonctionnaires de la CIA, ainsi que le vice-président Cheney, exhortèrent le journal à ne pas publier l’information », indique le rapport de 2014. « Bien que le journal américain n’eût pas révélé que le pays [expurgé] était le lieu où était détenu Abu Zubaydah, le fait qu’il disposait de l’information, combiné à l’intérêt antérieur des médias, entraîna la décision de fermer le site de détention Green. »)
Mes récits soulevant des questions sur les prétentions de l’administration à établir un lien entre l’Irak et Al-Qaïda furent coupés, enterrés ou complètement censurés par le journal.
En 2002, je commençais également à entrer en conflit avec les rédacteurs en chef au sujet de notre couverture des allégations de l’administration Bush concernant les renseignements d’avant-guerre sur l’Irak. Mes récits soulevant des questions sur le renseignement, en particulier les affirmations de l’administration selon lesquelles il y aurait eu un lien entre l’Irak et Al-Qaïda, étaient coupés, enterrés ou n’étaient pas publiés par le journal..
L’un des rares articles que j’ai réussi à faire publier en première page jetait le doute sur les informations selon lesquelles un agent de renseignement irakien aurait rencontré un des comploteurs du 11/9, Mohamed Atta, à Prague, avant les attentats de New York et Washington. Mais Doug Frantz, alors rédacteur en chef des enquêtes à New York, estimait qu’il devait le glisser en douce sur la page 1. « Compte tenu de l’atmosphère qui régnait parmi les rédacteurs en chef du Times, je m’inquiétai que l’article ne réussisse pas à faire la première page un jour où tout le monde se réunissait autour de la table », m’a écrit Frantz récemment. « J’ai donc décidé qu’il était trop important pour apparaître dans les autres pages du journal et je le proposai un dimanche, un jour où les rédacteurs en chef n’étaient pas souvent présents dans la discussion. »
De nombreuses personnes au journal pensaient que le rédacteur en chef de l’époque, Howell Raines, préférait les articles qui soutenaient le bien-fondé de la guerre. Mais Raines dit maintenant qu’il n’était pas pro-guerre, et qu’il ne s’est pas opposé à ce que mon histoire sur Prague fasse la une. « Je n’ai jamais dit à personne, à aucun niveau du Times, que je voulais des histoires qui soutiennent la guerre », m’a-t-il dit dans un courriel.
Pendant ce temps, Judy Miller, une journaliste passionnée basée à New York mais qui avait des sources au plus haut niveau de l’administration Bush, enchaînait les articles qui semblaient démontrer l’existence des armes de destruction massive en Irak. Ses récits ont aidé à établir le programme politique à Washington.
Miller et moi étions amis – en fait, j’étais probablement l’un de ses plus proches amis au bureau de Washington à l’époque. Au cours de l’année précédant le 11 septembre 2001, Miller avait travaillé sur une série remarquable d’articles au sujet d’Al-Qaïda, qui mettaient clairement en garde contre sa nouvelle puissance et ses nouvelles intentions. Dans les mois qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, elle et moi nous sommes efforcés de faire la lumière sur le rôle d’Al-Qaïda dans les attentats et la riposte antiterroriste des États-Unis. Nous faisions tous deux partie d’une équipe qui remporta le prix Pulitzer du reportage explicatif en 2002 pour notre couverture du terrorisme et du 11 septembre.
Mais dans les mois qui précédèrent l’invasion de l’Irak en mars 2003, alors que Miller et d’autres reporters du Times faisaient déferler une série de gros articles qui éblouirent les rédacteurs en chef, je commençai à être déçu de voir que si peu de mes sources dans la communauté du renseignement étaient prêtes à me parler de ce qu’elles pensaient des arguments avancés par l’administration Bush en faveur de la guerre. J’entendais sans cesse des plaintes à mots couverts selon lesquelles la Maison-Blanche faisait pression sur les analystes de la CIA pour qu’ils triturent les faits et livrent des rapports de renseignements qui suivaient la ligne du parti sur l’Irak. Mais quand j’insistais, peu étaient prêts à donner des détails. Des intermédiaires me disaient parfois qu’ils recevaient des appels angoissés d’analystes de la CIA, mais quand je leur demandais de parler, ils refusaient.
Après des semaines de reportages à la fin de 2002 et au début de 2003, j’avais pu rassembler suffisamment d’éléments pour commencer à écrire des articles qui révélaient que les analystes du renseignement étaient sceptiques quant aux preuves de l’administration Bush pour justifier l’entrée en guerre, en particulier les affirmations de l’administration selon lesquelles il y avait des liens entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda.
Mais après que j’eus déposé le premier article, il resta dans le système informatique du Times pendant des jours, puis des semaines, restant intouché par les rédacteurs. J’interrogeai plusieurs rédacteurs sur le statut de l’article, mais personne ne savait.
Finalement, l’article fut publié, mais il avait été fortement expurgé et enterré au fin fond du journal. J’en écrivis un autre, et la même chose se produisit. J’essayai d’en écrire davantage, mais je commençais à comprendre le message. Il me semblait que le Times ne voulait pas de ces articles.
Ce qui m’irrita le plus, c’est que pendant qu’ils enterraient mes articles sceptiques, les rédacteurs ne faisaient pas seulement les gros titres avec des articles affirmant que l’Irak possédait des armes de destruction massive, ils exigeaient aussi que je les aide à faire correspondre des articles d’autres publications sur les prétendues ADM. J’en eus tellement marre que lorsque le Washington Post rapporta que l’Irak avait fourni du gaz neurotoxique aux terroristes, je refusai d’essayer de faire correspondre l’histoire. Un rédacteur en chef du bureau de Washington me cria dessus pour mon refus. Il vint à mon bureau avec un club de golf en me réprimandant après que je lui eus dit que l’histoire était un tissu de conneries et que je n’allais pas passer de coups de fil.
En guise de geste de protestation, je mis une pancarte sur mon bureau qui disait : « Vous fournissez les photos, je me charge de la guerre ». C’était la prétendue phrase de William Randolph Hearst, éditeur du New York Journal, à l’artiste Frederic Remington, qu’il avait envoyé à Cuba pour y décrire la « crise » avant la guerre hispano-américaine. Mes rédacteurs ne remarquèrent même pas le panneau.

U. S. Marines en mission dans la banlieue de Bagdad, en Irak, le 6 avril 2003. Photo : Gilles Bassigna/Gamma-Rapho/Getty Images
Alors que l’invasion de l’Irak était sur le point de commencer, je commençai à travailler sur une curieuse histoire qui m’aida à oublier mes batailles avec le Times au sujet des renseignement d’avant-guerre.
Je dois avouer que c’était étrange de faire une interview nu, mais c’est ce qu’une source clé exigeait.
En mars 2003, je me rendis à Dubaï pour interviewer un homme très anxieux. Il avait fallu des semaines de négociations, par le biais d’une série d’intermédiaires, pour organiser notre rencontre. Nous nous mîmes d’accord sur un hôtel de luxe à Dubaï, la capitale moderne des complots du Moyen-Orient.
Cependant, juste avant de nous réunir, la source imposa de nouvelles exigences. Il faudrait que l’on se parle nus dans le sauna de l’hôtel. Il voulait être sûr de ne pas être enregistré. Cela m’empêcha également de prendre des notes avant la fin de notre rencontre.
Mais ça en valait la peine. Il me raconta comment le Qatar avait offert l’asile à Khalid Cheikh Mohammed dans les années 1990, lorsqu’il était recherché pour ses liens avec un complot visant à faire exploser des avions de ligne américains. Les représentants qataris avaient offert à KCM un emploi de fonctionnaire et par la suite, l’avaient apparemment alerté quand le FBI et la CIA étaient sur le point de l’attraper, lui permettant de prendre la fuite en Afghanistan où il rejoignit les forces de ben Laden et où il devint le cerveau des attaques du 11 Septembre.
Plus tard, je pus vérifier cette histoire, qui était particulièrement importante du fait de la présence au Qatar du quartier général avancé de l’U.S Central Command, le centre de commandement militaire responsable de l’invasion de l’Irak.
Après la publication de cette histoire, je me sentis revigoré.
Ce printemps-là, juste au début de l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis, j’appelai la CIA pour recueillir leurs commentaires sur une affaire farfelue d’opération visant à remettre à l’Iran des plans nucléaires. L’opération voulait que la CIA donne aux Iraniens des plans erronés et que Téhéran s’en serve pour fabriquer une bombe qui serait en réalité inutilisable.
Le problème résidait dans l’exécution du plan secret. La CIA avait emprunté des plans nucléaires russes fournis par un russe passé du côté américain, que des scientifiques américains avaient ensuite truffés d’erreurs. La CIA avaient alors demandé à un autre Russe d’approcher les Iraniens. Il devait prétendre essayer de vendre ces documents à l’acheteur le plus offrant.
Mais les erreurs de conception dans les plans étaient flagrantes. Le russe qui était supposé les remettre eut peur que les Iraniens se rendent compte trop rapidement de la présence de ces erreurs et d’avoir des ennuis. Pour se protéger au moment de la remise des documents à la mission iranienne présente à Vienne, il ajouta une lettre mettant en garde contre la présence d’erreurs dans les plans. Ainsi, les Iraniens reçurent les plans nucléaires et furent aussi prévenus de la nécessité de chercher les erreurs qui y étaient incluses.
De nombreux représentants de la CIA pensaient que l’opération avait été mal orchestrée ou du moins avait échoué à atteindre ses objectifs. En Mai 2003, j’avais confirmé l’histoire grâce à de nombreuses sources, écrit un brouillon et appelé le bureau des relations publiques de la CIA pour recueillir leurs commentaires.
Au lieu de me répondre, la Maison Blanche appela immédiatement la directrice du bureau de Washington Jill Abramson et exigea d’organiser une réunion.
Condoleezza Rice me regarda droit dans les yeux. J’avais reçu des informations si sensibles que j’avais pour obligation d’oublier toute cette histoire, dit-elle.
Le jour suivant, Abramson et moi nous rendîmes dans l’aile ouest de la Maison-Blanche pour rencontrer la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice. Dans son bureau, situé au bout du couloir menant au Bureau Ovale, nous nous assîmes face à Rice et George Tenet, directeur de la CIA, ainsi que deux de leurs conseillers.
Rice me regarda droit dans les yeux. J’avais reçu des informations si sensibles que j’avais pour obligation d’oublier toute cette histoire, de détruire mes notes et de ne plus jamais appeler pour discuter de cette affaire avec qui que ce soit, dit-elle. Elle nous dit, à Abramson et moi, que le New York Times ne devrait jamais publier cette histoire.
J’essayai de retourner la situation. Je posai quelques questions à Tenet sur le programme iranien, parvint à obtenir confirmation de la véracité de l’affaire et il me fournit même quelques détails que je n’avais jamais entendus auparavant. Le seul point de controverse portait sur la mauvaise organisation de l’opération.
Rice affirma que l’opération était une alternative à une invasion complète de l’Iran, à l’image de la guerre que le président George W. Bush venait juste de déclarer en Irak. Je me rappelle l’avoir entendue dire : « Vous nous critiquez parce que nous déclarons la guerre à cause d’armes de destruction massive. Et bien c’est ce que nous pouvons faire à la place ». (Des années plus tard, quand Rice témoigna dans le procès Stirling, une copie des « points de discussion » qu’elle avait préparé pour nos entretiens fut inscrite sur la liste des preuves, même si je ne me rappelle pas l’avoir entendue évoquer beaucoup de ces points.)
Abramson dit à Rice et Tenet que la décision de publier l’article appartenait au rédacteur en chef du Times, Howell
Raines. Après la réunion, Abramson et moi nous sommes arrêtés pour déjeuner. Nous étions tous les deux abasourdis par le tir d’artillerie que nous venions d’essuyer. Mais je me rendais aussi compte que je venais d’obtenir une confirmation de haut niveau de cette histoire – une confirmation meilleure que je n’aurais jamais pu l’imaginer.
Juste après notre rencontre avec Tenet et Rice, le scandale de Jayson Blair éclata, forçant Raines à livrer une bataille intense pour sauver son emploi. Blair peut avoir été la cause immédiate de la crise, mais parmi le personnel du Times, Blair ne fut que le déclencheur qui permit à la rancœur accumulée contre Raines à cause de son mode de gestion de se manifester.
Abramson se souvient qu’après notre rencontre avec Rice, elle avait transmis l’histoire de l’Iran à Raines et au rédacteur en chef de l’époque, Gerald Boyd. Abramson m’a dit récemment : « Ils m’ont opposé un « non » rapide à la publication de l’article ». Elle a dit qu’elle avait dit à Raines et Boyd que Rice était prête à discuter de l’histoire avec eux sur une ligne téléphonique sécurisée qu’ils pourraient utiliser depuis d’une installation située dans l’est de Manhattan, mais elle a dit qu’ils n’avaient jamais demandé à faire ce pas, et elle ne les a pas poussés à le faire. Raines conteste cela. « Je n’ai pas été informé de cette rencontre [avec Rice et Tenet], et je ne me souviens pas non plus d’avoir été impliqué dans votre histoire de quelque façon que ce soit », a-t-il dit dans un courriel. (Boyd est mort en 2006.)
Raines quitta le journal au début du mois de juin 2003. Joe Lelyveld, le rédacteur en chef à la retraite, revint brièvement pour diriger le Times sur une base intérimaire. Je lui parlai par téléphone de l’histoire de l’Iran, mais il n’avait pas vraiment le temps de s’en occuper.
Lorsque Bill Keller fut nommé rédacteur en chef à l’été 2003, il accepta de discuter de l’histoire avec Abramson et moi. Entre-temps, Abramson avait été promu au poste de rédacteur en chef, le N°2 de Keller. Après avoir examiné l’article avec lui, Keller décida de ne pas le publier. J’essayai de le faire changer d’avis pendant toute l’année qui suivit, en vain.
Le torpillage de l’article sur l’Iran, survenant si peu de temps après les combats internes au sujet de la couverture des ADM, m’avait laissé déprimé. Je commençai à réfléchir à la possibilité d’écrire un livre qui inclurait l’histoire de l’Iran et qui présenterait la guerre contre le terrorisme d’une manière plus large que je ne pensais pouvoir le faire dans le Times.
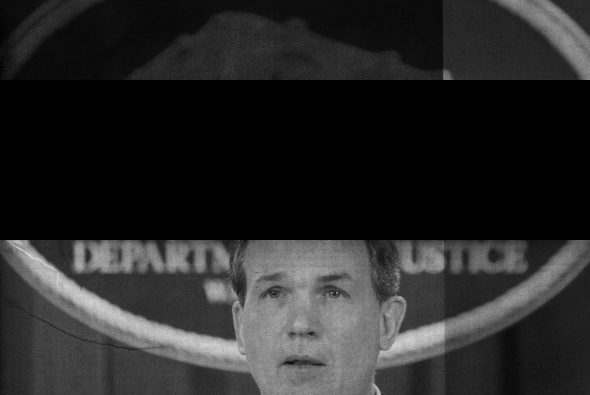
Le procureur fédéral des États-Unis Patrick Fitzgerald prend la parole lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice le 28 octobre 2005, à Washington, D.C. Photo : Mandel Ngan/AFP/Getty Images
L’administration Bush réussissait à convaincre la presse de retenir ou de supprimer les reportages sur la sécurité nationale, mais le gouvernement n’avait pas encore lancé de campagne agressive pour traquer les lanceurs d’alerte et les journalistes. Tout changea avec l’affaire Valerie Plame.
En décembre 2003, le ministère de la Justice nomma Patrick Fitzgerald, alors procureur des États-Unis à Chicago, conseiller spécial chargé d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des hauts responsables de la Maison-Blanche auraient divulgué illégalement l’identité secrète de Plame comme agent de la CIA. Les détracteurs affirmaient que la Maison-Blanche de Bush l’avait vendue à la presse en guise de représailles contre son mari, l’ancien diplomate américain Joseph Wilson, qui avait critiqué la guerre en Irak.
Les libéraux anti-Bush voyaient l’affaire Valerie Plame et l’enquête sur les fuites comme une bataille par procuration au sujet de la guerre en Irak, plutôt que comme une menace potentielle pour la liberté de la presse.
Sans penser aux conséquences à long terme, de nombreux médias applaudirent Fitzgerald, l’exhortant à poursuivre énergiquement les hauts responsables de l’administration Bush pour découvrir qui était la source de la fuite. Les libéraux anti-Bush voyaient l’affaire Plame et l’enquête sur la fuite de Fitzgerald comme une lutte par procuration contre la guerre en Irak, plutôt que comme une menace potentielle pour la liberté de la presse.
Fitzgerald, un procureur semblable à l’inspecteur Javert dont le statut de conseiller spécial signifiait que personne au ministère de la Justice ne pouvait contrôler son action, commença à assigner à comparaître des journalistes de tout Washington et à exiger qu’ils témoignent devant un grand jury.
Il y eut à peine un murmure de désaccord de la part des libéraux quand Fitzgerald pressa un grand reporter après l’autre pour obtenir des informations. Seule Judy Miller préféra aller en prison plutôt que de coopérer. (Elle finit par témoigner après avoir reçu une décharge de sa source, I. Lewis « Scooter » Libby, un proche conseiller du vice-président Dick Cheney.)
Fitzgerald acquit une réputation de procureur coriace et pragmatique, et le fait qu’il ait malmené la presse de Washington n’entacha pas sa réputation. Il devint par la suite associé dans l’un des principaux cabinets d’avocats américains.
L’affaire Plame finit par se dissiper, mais elle avait créé un dangereux précédent. Fitzgerald avait assigné des journalistes à comparaître et les avait forcés à témoigner, devenant ainsi la plus grande vedette du ministère de la Justice. Il avait fait tomber les contraintes politiques, sociales et juridiques qui dissuadaient jusqu’alors les responsables gouvernementaux de s’en prendre aux journalistes et à leurs sources. Il devint un modèle pour les procureurs de carrière, qui voyaient que l’on pouvait monter au sommet du ministère de la Justice en s’attaquant aux journalistes et à leurs sources.
Les fonctionnaires de la Maison-Blanche, quant à eux, constatèrent que cibler les journalistes et mener des enquêtes agressives sur les fuites n’avait pas causé autant de revers politiques que prévu. L’entente informelle établie depuis des décennies entre le gouvernement et la presse – selon laquelle le gouvernement n’agirait que pour la forme dans le cadre d’enquêtes sur les fuites – était morte.
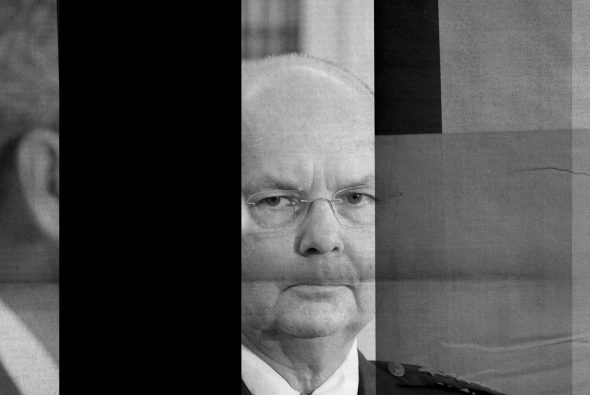
Le regard de Michael Hayden, nommé au poste de nouveau directeur de la CIA, lors d’une annonce concernant le personnel le 8 mai 2006, au bureau ovale de la Maison-Blanche. Photo: Roger Wollenberg-Pool/Getty Images
3. STELLAR WIND
[« Stellar Wind » ou « vent solaire » est le nom de code d’un programme de surveillance lancé sous l’administration Bush peu après le 11/09/2001, NdT]
À l’été 2003, le New York Times nomma Philip Taubman, un vieil ami de Bill Keller, nouveau chef du bureau de Washington. Taubman avait été le chef du bureau du Times de Moscou lorsque Keller avait remporté un prix Pulitzer en tant que correspondant là-bas. Taubman était à présent l’homme de Keller à Washington.
Taubman et moi nouâmes une relation amicale. Plus tôt au cours de sa carrière, il avait couvert des questions de sécurité nationale et de renseignement, et il semblait avide de scoops. Mais en 2004, je commençai à être en désaccord avec certaines de ses décisions. Ce printemps-là, j’appris que l’administration Bush avait découvert qu’Ahmad Chalabi, l’enfant prodige des néoconservateurs en Irak, avait dit à un responsable du renseignement iranien que l’Agence nationale de sécurité avait décrypté les codes iraniens.
C’était une énorme trahison de la part de l’homme que certains hauts responsables de l’administration Bush avaient autrefois envisagé d’installer à la tête du gouvernement irakien. Mais après que j’eus appelé la CIA et la NSA pour obtenir leurs commentaires, le directeur de la NSA, Michael Hayden, appela Taubman et lui demanda de ne pas publier l’article. Hayden soutenait que même si Chalabi avait dit aux Iraniens que les États-Unis avaient décrypté leurs codes, il n’était pas certain que les Iraniens le croyaient, et ils utilisaient toujours les mêmes systèmes de communication.
Taubman accepta, et nous nous sommes assis sur l’histoire jusqu’à ce que le bureau des affaires publiques de la CIA l’appelle et lui dise que quelqu’un d’autre la couvrait, et que nous ne devrions plus nous sentir obligés de ne pas publier. J’étais en colère parce que j’avais perdu une exclusivité, et je croyais que les arguments de Hayden contre la publication avaient été conçus simplement pour épargner de l’embarras à la Maison-Blanche au sujet de Chalabi.
Tout à coup, alors que nous étions à la porte d’entrée de la source, tout sortit.
Au printemps 2004, alors que l’affaire Plame s’intensifiait et commençait à changer la dynamique entre le gouvernement et la presse, je rencontrai une source qui me dit de façon énigmatique qu’il se passait quelque chose de vraiment énorme et de vraiment secret au sein du gouvernement. C’était le plus grand secret que la source eût jamais entendu. Mais la source était trop nerveuse pour en parler avec moi. Une nouvelle crainte au sujet d’enquêtes approfondies sur les fuites se répandait. Je décidai de rester en contact avec la source et de soulever à nouveau la question.
Au cours des mois qui suivirent, je rencontrai la source à maintes reprises, mais la personne ne semblait jamais disposée à divulguer ce que nous avions commencé à appeler « le plus grand secret ». Enfin, à la fin de l’été 2004, alors que je terminais un entretien avec la source, je déclarai que je devais connaître le secret. Tout à coup, alors que nous étions à la porte d’entrée de la source, tout sortit. Au cours d’une dizaine de minutes, la source fournit un aperçu détaillé du vaste programme d’espionnage national de la NSA après le 11 septembre 2001, dont j’appris plus tard qu’il portait le nom de code Stellar Wind.
La source m’apprit que la NSA avait mis sur écoute des Américains sans mandat, sans l’approbation du tribunal. La NSA recueillait également les enregistrements téléphoniques et électroniques de millions d’Américains. L’opération avait été autorisée par le président. L’administration Bush était engagée dans un vaste programme d’espionnage intérieur qui était probablement illégal et inconstitutionnel, et seule une poignée de personnes soigneusement sélectionnées au sein du gouvernement le savait.
Je restai sous le choc après cette rencontre, mais en tant que journaliste, j’étais aussi ravi. Je savais que c’était l’histoire d’une vie.
La NSA avait suivi des règles strictes contre l’espionnage domestique pendant 30 ans, depuis que l’enquête de la commission Church [commission formée à l’initiative du Sénat des États-Unis et dirigée en 1975 par le sénateur démocrate Frank Church. Elle a été formée à la suite du scandale du Watergate, NdT] sur les abus commis par les services de renseignement dans les années 1970 avait conduit à une série de réformes. Une des mesures de la réforme, la loi de 1978 sur la surveillance du renseignement étranger, rendait illégale l’écoute clandestine des Américains par la NSA sans l’approbation d’un tribunal secret de la FISA [Foreign Intelligence Surveillance Act, NdT]. Ma source venait de me révéler que l’administration Bush ignorait secrètement la loi exigeant des mandats de perquisition du tribunal de la FISA.
Rapidement, je commençai à penser à la façon dont je pourrais confirmer cette histoire et par chance, je trouvai la bonne personne, une source qui d’habitude n’aimait pas livrer beaucoup d’informations mais qui acceptais parfois de confirmer ce que j’avais entendu dire ailleurs. Alors que nous étions assis seuls dans un bar tranquille, je dis à la source ce que j’avais entendu dire sur le programme de la NSA et immédiatement, il fut clair que la source était au courant de ce secret qui la troublait.
La source m’expliqua de nombreux détails techniques du programme secret d’espionnage national mené par la NSA pour l’administration Bush, me décrivant comment la NSA avait pris le contrôle des passerelles d’échanges géantes présentes le long des frontières entre les réseaux de télécommunications domestique et internationale dans le but d’aspirer l’ensemble du trafic téléphonique international ainsi que les courriels envoyés ou reçus par des Américains.
Alors que je travaillais pour trouver plus de personnes avec qui parler de cette histoire, je réalisai que le journaliste assis à côté de moi au bureau de Washington, Eric Lichtblau, entendait dire des choses similaires. Lichtblau couvrait le Département de la Justice. Quand il est arrivé au journal en 2002, j’avais été jaloux de ses talents de journaliste, plus particulièrement de sa capacité à développer son réseau de sources. Je laissai parfois ma rancœur prendre le dessus ; je me rappelle d’une rencontre avec Abramson pendant laquelle j’avais été ouvertement dédaigneux d’une histoire exclusive sur laquelle travaillait Lichtblau. Mais il ne m’en a jamais tenu rigueur et nous commençâmes à devenir amis et à collaborer pour certains articles.
Litchblau avait appris d’une source que quelque chose de potentiellement illégal se passait au DOJ [Ndt : Department of Justice, Département de la Justice], que ses représentants semblaient passer outre les lois nécessitant l’obtention de mandats pour la mise sur écoute et que le Ministre de la Justice John Ashcroft pourrait être impliqué.
Lichtblau et moi comparâmes nos notes et nous réalisâmes que nous entendions probablement parler de la même histoire. Nous décidâmes de travailler ensemble.
Chacun de nous continua à creuser, parlant à plus de personnes. Nous commençâmes à faire des entretiens communs et découvrîmes que nous avions des façons de pratiquer le journalisme très différentes. Alors que j’aimais laisser la source parler de tout ce qui lui passait par la tête, Lichtblau aimait aller directement à l’essentiel, quitte à harceler ses sources pour leurs faire cracher leurs informations. Nos approches étaient complémentaires et nous développâmes malgré nous une dynamique de bon flic-mauvais flic. Lichtblau donnait souvent à nos sources des surnoms imagés, ce qui nous permettait de parler plus facilement d’elles sans révéler leurs identités. Il surnomma une source précoce de l’affaire de la NSA « Vomit Guy » parce que quand il dit à cette source de quoi il voulait parler, la source dit à Litchblau qu’il était tellement écœuré par ce sujet qu’il en avait envie de vomir.
A l’automne 2004, nous avions un brouillon de cette l’histoire. Je sentais qu’il était temps de franchir la porte d’entrée et je décidai de façon impulsive de mentir pour me frayer un chemin jusqu’aux plus hautes sphères de la NSA. J’appelai le porte-parole de la NSA, Judy Emmel, et lui dis que je devais immédiatement parler à Hayden. Je lui dis que c’était urgent et que l’objet de mon appel était confidentiel.
Elle me mit en communication tout de suite. J’étais abasourdi que mon bluff ait marché mais maintenant que j’étais en communication avec Hayden, je devais me dépêcher de penser à ce que je voulais lui demander. Je décidai de lui lire les premiers paragraphes du brouillon que Lichtblau et moi rédigions. Lichtblau était assis à côté de moi, me fixant attentivement pendant que je lisais au téléphone à Hayden le début de l’article. J’étais assis devant mon ordinateur, prêt à noter tout ce que dirait Hayden.
Après avoir lu les premiers paragraphes, Hayden poussa un cri de surprise puis bégaya pendant un moment. Finalement, il dit que peu importait ce que faisait la NSA, c’était légal et opérationnellement valide. Je le poussai davantage mais il refusa d’en dire plus et raccrocha.
L’administration Bush s’était engagée dans un programme massif d’espionnage national qui était probablement illégal et anticonstitutionnel et seulement une poignée de personnes du gouvernement triées sur le volet étaient au courant.
Hayden avait pratiquement confirmé cette histoire. Il semblait évident d’après sa réaction qu’il savait exactement de quoi je parlais et il avait commencé à se défendre avant de décider de mettre un terme à la conversation. Après avoir expliqué à Litchblau ce que Hayden venait de dire, je me dirigeai vers le bureau de Taubman pour lui apprendre la nouvelle. « Je pensais que c’était un scoop sensationnel mais je savais que nous serions confrontés à des questions difficiles concernant sa publication et le fait qu’elle puisse saper les efforts américains pour empêcher la survenue d’une attaque similaire à celle du 11 Septembre » me confiait récemment Taubman dans un courriel.
Quelques jours plus tard, Hayden appela Taubman et lui demanda de ne pas publier l’histoire sur la NSA. Taubman écouta mais resta réservé. C’était le début de ce qui se transforma en plus d’une année de négociations entre le Times et l’administration Bush car les hauts-fonctionnaires cherchèrent à maintes reprises à supprimer l’histoire sur la NSA.
Quelques jours plus tard, Taubman et moi nous rendîmes au Old Executive Office Building [NdT : bâtiment annexe de la Maison-Blanche abritant le bureau exécutif du Président américain] pour rencontrer John McLaughlin, alors directeur intérimaire de la CIA après avoir récemment remplacé Tenet à ce poste, ainsi que John Moseman, directeur de cabinet de McLaughlin. Nous nous rencontrâmes dans le bureau que le directeur de la CIA occupait dans l’OEB [NdT : Old Executive Office Building] pour rester proches de la Maison-Blanche. La rencontre, première d’une longue série entre le Times et le gouvernement à propos de l’affaire de la NSA, fut étrange. A la différence de ma rencontre avec Tenet et Rice à propos de l’histoire iranienne, qui avaient confirmé l’histoire tout en nous demandant de l’étouffer, McLaughlin et Moseman refusèrent catégoriquement de confirmer que l’affaire de la NSA était vraie, même quand ils nous demandèrent de ne pas la sortir. Ils continuèrent à employer des termes hypothétiques, disant que si un tel programme existait, il serait important pour les États-Unis qu’il reste secret et que les journaux américains ne devraient pas en parler.
J’avais maintenant été confronté de nombreuses fois à cette façon de procéder de l’administration Bush et leurs mises en garde désespérées quant à la sécurité nationale ne m’impressionnaient plus. Ils avaient crié au loup de trop nombreuses fois pour rester crédibles.
Taubman ne leur donna aucune réponse quant à la publication de l’article par le Times, leur disant que la décision reviendrait à Keller. Il leur demanda également de nous avertir s’ils apprenaient qu’une autre organisation traitait la même histoire.
Dans ses mémoires Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror publiées en 2016, Hayden se souvient que ce qu’il avait entendu de McLaughlin et Moseman l’avait convaincu de la possibilité de négocier avec Taubman mais pas avec moi. « Taubman semblait être réfléchi et complètement réfléchi. Risen était décrit comme quelqu’un d’odieux, d’ergoteur et de combatif, ne commentant que pour contester avec pour leitmotiv le droit du public d’être au courant », écrit Hayden. « Des notes contemporaines indiquaient que Taubman comprenait le sérieux de la question alors que Risen n’en avait franchement rien à faire ». Hayden écrit qu’en conséquence de cette estimation, « nous devînmes plutôt communicatifs – avec Taubman. »
Alors que Lichtblau et moi continuions notre enquête, nous réalisâmes que nous devions acquérir une meilleure compréhension de la façon dont fonctionnent les réseaux de télécommunications américains et internationaux. Je passai une journée à la bibliothèque de l’Université de Georgetown à lire attentivement revues techniques et travaux académiques portant sur l’industrie des télécommunications. J’appelai le siège d’AT&T’s [NdT : compagnie américaine de télécommunications] et dis au porte-parole de la compagnie que je voulais en apprendre plus sur l’infrastructure du système téléphonique et plus particulièrement sur les gros commutateurs qui redirigeaient les trafics téléphonique et internet aux États-Unis. Je ne dis pas au porte-parole la raison de mon intérêt pour ces problèmes obscurs, sinon que c’était pour un article pour le New York Times.
Au début, le porte-parole fut très aimable et coopératif et dit qu’il serait heureux de me mettre en contact avec des experts techniques d’AT&T, ajoutant qu’il pourrait être en mesure d’organiser une visite de leurs locaux. Mais je n’entendis plus jamais parler de lui. Je rappelai plusieurs fois mais il ne me rappela jamais. J’ai finalement deviné que quelqu’un au sein de l’administration Bush avait vivement conseillé à AT&T de ne plus me parler.

Bill Keller, ancien rédacteur en chef du New York Times, en 2013. Photo: Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images
Au cours du mois d’octobre 2014, Lichtblau et moi continuâmes à enquêter et écrire. Parfois, nous écrivions depuis ma maison située en dehors de Washington, prenant des pauses pour regarder les épiques play-offs de base-ball entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York. Rebecca Corbett, notre rédactrice du bureau de Washington, avait travaillé avec nous sur l’article.
Nous opérions avec en toile de fond la campagne présidentielle de 2004 opposant George W. Bush et John Kerry. Une semaine ou deux avant l’élection, Lichtblau et moi, ainsi que Corbett et Taubman, nous rendîmes à New York pour rencontrer Keller et Abramson et décider si l’histoire serait publiée ou non.
Nous nous assîmes dans l’alcôve située à l’arrière du bureau de Keller dans le vieux bâtiment du Times situé sur la 43ème rue. C’était un recoin confortable aux murs tapissés de livres dans lequel j’étais venu une fois auparavant, quand j’avais essayé de faire changer d’avis Keller pour la publication de l’article CIA-Iran. Lichtblau, Corbett et moi plaidâmes fermement en faveur de la publication de l’article sur la NSA.
Dans cette petite pièce, nous nous lançâmes dans un vif débat sur la possible publication de l’article, dominé par la tension intrinsèque entre la sécurité nationale et le droit du public d’être informé. Un des problèmes centraux tenait dans la légalité du programme de la NSA. Keller semblait sceptique quant aux arguments de nos sources affirmant que le programme était illégal et potentiellement anticonstitutionnel. Il y eut des échanges tendus.
Je dis à Keller que je pensais que c’était le genre d’histoire qui avait forgé le prestige du New York Times dans les années 1970, quand Seymour Hersh avait révélé une séries d’abus de la part des services de renseignement. Keller ne sembla pas impressionné ; de mémoire, il qualifia ma comparaison de l’affaire de la NSA avec le travail d’Hersh de « facile ». (Je ne pense pas que ma remarque était creuse mais elle était probablement arrogante.)
Alors que la réunion se prolongeait et que Keller restait peu convaincu par chacune des raisons que nous avançions en faveur de la parution de l’article, mon désespoir grandissait de ne pas parvenir à trouver l’argument qui le ferait changer d’avis. Finalement, Je lui dis que si nous ne sortions pas l’histoire avant l’élection, une source essentielle pourrait bien aller voir ailleurs et un autre journal pourrait alors la publier.
C’était le pire argument à donner à Keller. Il fit machine arrière, se demandant à voix haute si la source n’avait pas une arrière-pensée politique. Il dit qu’il ne céderait pas à la contrainte pour publier l’article avant l’élection car il ne voulait pas laisser un impact politique potentiel affecter sa prise de décision journalistique. Je soulignai que s’il décidait de ne pas sortir cette histoire avant l’élection, ça aurait aussi un impact mais il sembla ignorer mon commentaire.
A la fin de la réunion, il dit qu’il avait décidé de ne pas publier l’article. Dans une interview récente, Keller a admis que mon argument selon lequel une des sources pourrait parler de cette histoire à un autre journal avait eu une influence sur sa décision. « Ça a allumé le signal d’alarme dans ma tête », se souvient Keller, ajoutant qu’il avait pensé « nous avons une source cruciale hostile ».
Maintenant, Keller dit aussi que le climat général qui régnait dans le pays en 2004 place sa décision de ne pas publier cet article dans un contexte important. Dans un entretien datant de 2013 avec la rédactrice publique [personne attachée à un journal et disposant d’une rubrique en première page pour évaluer et éventuellement critiquer la ligne éditorial, qui sert aussi de médiateur avec le public, NdT]du Times de l’époque Margaret Sullivan, il revint sur cette histoire, disant que « trois ans après le 11 Septembre, nous, en tant que nation, étions encore sous le choc du traumatisme, et nous, en tant que journaux, n’en étions pas immunisés. Ce n’était pas une sorte d’extase patriotique. C’était un sentiment aigu que le monde était un endroit dangereux. »
Le rejet de Keller était un revers. Mais après l’élection, Lichtblau et moi convainquîmes les rédacteurs de nous laisser reprendre notre travail sur cette histoire. Alors que nous cherchions d’autres sources, nous commençâmes à sentir l’effet dissuasif de la nouvelle approche du gouvernement concernant les enquêtes sur les fuites. Au sein du petit cercle de personnes du gouvernement qui était au courant du programme de la NSA, nombreux étaient ceux qui savaient que nous enquêtions sur celui-ci et qui avaient peur de nous parler. Par une nuit neigeuse de Décembre 2004, nous nous rendîmes au domicile d’un représentant qui, selon Lichtblau, était au courant du programme de la NSA. Quand il ouvrit la porte, il reconnu Lichtblau et devina rapidement la raison de notre venue. Il commença à nous réprimander pour être venus à l’improviste, nous dit de partir immédiatement et referma la porte. Il semblait inquiet que quelqu’un ait pu nous voir devant chez lui.
Une fois de plus, le journal reprit ses réunions avec les plus hauts représentants de l’administration qui voulaient nous empêcher de publier cette histoire. Au cours des semaines qui suivirent l’élection, Lichtblau, Taubman et moi nous rendîmes au Département de la Justice pour rencontrer James Comey, adjoint du ministre de la Justice et Alberto Gonzales, conseiller de la Maison-Blanche. Ashcroft venait de démissionner, et même si ça n’avait pas encore été annoncé, il était clair que Gonzales était sur le point de le remplacer au poste de ministre de la Justice. C’était maintenant au tour de Gonzales de nous convaincre d’enterrer cette histoire.
Mais quand la réunion débuta, c’est à peine si Gonzales prononça quelques mots ; il semblait que l’administration était momentanément heureuse d’avoir traversé la période électorale sans que notre article ait été publié et l’ambiance dans la salle de réunion était plus détendue que d’habitude. Comey fut celui qui parla le plus. Même s’il admettait avoir quelques scrupules à propos du programme, il continua d’insister sur son caractère trop important pour être rendu public et que nous ne devions pas publier notre article. (Comey ne révéla pas que lui-même, ainsi que plusieurs autres hauts représentants du Département de la Justice et le directeur de l’époque du FBI Robert Mueller avaient failli démissionner en raison de certains aspects du programme un peu plus tôt au cours de l’année 2004.)
Au même moment, Hayden, qui avait clairement décidé de concentrer sur Taubman sa campagne de lobbying visant à empêcher le Times de publier l’histoire, l’invita au siège de la NSA mais sans Lichtblau ni moi, et l’autorisa à discuter avec des représentants de la NSA directement impliqués dans le programme d’espionnage national. A la suite de quoi, Taubman nous dit, à Lichtblau et moi, qu’il ne pouvait pas nous dire ce qu’il avait appris. Aujourd’hui, Taubman dit que l’objectif de Hayden « était de me montrer le programme de façon officieuse pour que je comprenne mieux son fonctionnement et pourquoi sa révélation nuirait à la sécurité nationale des États-Unis. »
« Quand je suis revenu au bureau, je me rappelle que sans surprise, Eric et toi étiez impatients de connaître les détails de la réunion », me dit Taubman dans un courriel. « J’ai décrit ma visite de façon générale mais j’ai dit que j’avais accepté de ne rien dire des détails techniques que j’avais appris mais d’utiliser mes connaissances en vous disant si je voyais quoi que ce soit dans votre brouillon de l’article que je pensais être incorrect. »
« Quand quelqu’un vous donne ce genre d’accès et vous dit que des vies sont en jeu, vous le prenez au sérieux » – Bill Keller
Keller dit maintenant que la relation de Taubman avec Hayden joua un rôle important dans sa décision de ne pas publier l’histoire. « Un des facteurs était certainement le fait que Taubman connaissait plutôt bien Hayden et lui faisait confiance », me dit Keller. « Hayden invita Taubman à l’endroit même où les gars travaillaient sur le programme de la NSA. Quand quelqu’un vous donne ce genre d’accès et vous dis que des vies sont en jeu, vous le prennez au sérieux. »
Au même moment, la Maison Blanche décidait d’engager les membres du « Gang of Eight », une poignée de membres dirigeants du Congrès qui avaient été secrètement informés du programme alors que le reste du Congrès était maintenu dans l’ignorance. Jane Harman, démocrate haut placée membre du Comité de Renseignement de la Maison Blanche, appela Taubman et fit valoir ses arguments pour que le New York Times ne publie pas cette histoire.
Quand récemment j’ai questionné Taubman à ce sujet, il a sous endendu que l’appel d’Harman résultait de ses discussions avec le gouvernement. Taubman se rappelle avoir dit à Hayden ou RIce que le Times avait besoin d’entendre de la part des dirigeants des comités de renseignements du Congrès les noms de ceux qui étaient au courant de l’existence du programme. « Jane Harman accepta de me parler à la condition que l’appel soit officieux. Elle m’a dit qu’elle et ses collègues, Démocrates et Républicains, soutenaient vivement le travail de la NSA et exigeaient que le [Times] ne le rende pas public. »
A la mi-Décembre 2004, l’histoire avait de nouveau été reportée, donc Lichtblau, Corbett et moi recommençâmes à plaider en faveur de sa parution dans le journal.
Cette fois, au lieu de nous rendre à New York, nous organisâmes une série de réunions secrètes avec Taubman dans son bureau de Washington. Les compte-rendus additionnels et le travail de ré-écriture ne l’impressionnèrent pas. Il acceptait les arguments de l’administration Bush selon lesquels l’article nuirait à la sécurité nationale. Il démolit l’histoire. Cette fois, Keller n’était pas directement impliqué dans nos réunions. L’histoire de la NSA sembla alors enterrée pour de bon.
J’étais sur le point de partir pour un congé prévu de longue date afin d’écrire un livre sur la CIA et l’administration Bush. J’étais furieux que le Times ait enterré les histoires sur l’Iran et la NSA et que la Maison Blanche ait réussi à dissimuler la vérité. Je me dis que si je continuais à accepter ces décisions de tronquer, enterrer ou purement supprimer tant d’articles, comme je l’avais fait au cours des dernières années, je ne pourrais plus me respecter moi-même.
Je décidai d’ajouter les affaires de l’Iran et de la NSA dans mon livre. J’étais quasiment sûr que ça mènerait à mon renvoi du Times. J’étais à bout de nerfs mais Penny, ma femme resta inflexible. « Je perdrai tout respect pour toi si tu ne le fais pas », me dit-elle, scellant ma décision.
Pendant toute la première partie de l’année 2005, je travaillai chez moi sur State of War, dont la publication devait être assurée début 2006 par Free Press, une filiale de Simon and Schuster. Après avoir écrit le chapitre sur le programme d’espionnage national de la NSA, j’appelai Lichtblau et lui demandai de venir chez moi. À son arrivée, je lui dis de s’asseoir, de lire le chapitre et de me dire s’il était d’accord pour que j’ajoute cette histoire dans mon livre. Quand il eut fini sa lecture, il plaisanta en disant que j’avais enterré le chapeau [court texte en tête d’article concentrant l’essentiel de l’information de l’article, NdT] et je lui rappelai sèchement qu’écrire un livre était un travail différent de l’écriture d’articles. Il me donna son accord pour inclure le chapitre dans le livre comme il savait que l’histoire était enterrée au Times. Il me demanda simplement de le citer dans le chapitre – et d’écrire son nom correctement.
Pendant que j’étais en congé pour l’écriture de mon livre, Lichtblau était dans une position plus que difficile. Écarté par ses éditeurs de tout travail sur le programme de la NSA, il avait été affecté à la couverture du débat qui se tenait au Congrès à propos de la ré-autorisation du Patriot Act. Mais Lichtblau savait que le débat concernant la façon de trouver l’équilibre entre sécurité nationale et libertés individuelles était une mascarade tant que l’existence du programme d’espionnage national de la NSA serait caché au grand public. La Maison-Blanche autorisa le Congrès à débattre publiquement de cet équilibre, même après que George W. Bush eut secrètement décidé de quel côté pencherait la balance. « Étant au courant du programme de la NSA, je trouvai de plus en plus gênant de relater de façon sérieuse les sermons des uns et des autres », écrivit plus tard Lichtblaudans son livre Bush’s Law : The Remaking of AMerican Justice paru en 2008. « En revenant au bureau après une séance du Congrès concernant le Patriot Act que je couvrais en ce printemps 2005, j’étais tellement frustré que je me rendis directement au bureau de Rebecca Corbett pour lui suggérer qu’un quelqu’un d’autre devrait peut-être couvrir tout ce débat du Congrès ; vu ce que nous savions, lui dis-je, je ne me sentais plus à l’aise pour couvrir ce qui semblait être un jeu washingtonien de bonneteau… J’étais coincé dans cette histoire. »
Alors qu’il assistait à une séance du Congrès, Lichtblau écouta Harman plaider en faveur de restrictions plus serrées du Patriot Act pour éviter que des abus nuisent aux libertés individuelles. Lichtblau savait que Harman avait été mise au courant du programme de la NSA et avait appelé le Times pour enterrer notre histoire; il sortit donc à sa suite dans le hall pour lui en parler. Mais quand il lui demanda comment elle pouvait accorder ses demandes pour la limitation du Patriot Act avec ce qu’elle savait du programme de la NSA, Harman le réprimanda d’aborder le sujet. « Chassant ses assistants, elle m’agrippa par le bras et m’entraîna à l’écart, vers une partie plus reculée du couloir du Capitole », écrit-il dans son livre. « Vous ne devriez pas parler de ça ici », le houspilla-t-elle dans un murmure. « Ils ne sont même pas au courant de ça », dit-elle, désignant ses assistants, qui observaient maintenant notre conversation avec une confusion évidente. « Le Times a pris la bonne décision en ne publiant pas cet article. »
Je revins congé pour l’écriture de mon livre en mai 2005 et je terminai mon manuscrit plus tard cet été-là. À la fin de l’été ou au début de l’automne, après que j’eus remis les derniers chapitres à mon éditeur et alors que le processus d’édition chez Free Press était pratiquement terminé, je décidai de faire connaître au Times l’objet de mes travaux.
J’envoyai un courriel à Jill Abramson, qui était alors à New York, et je lui dis que je mettais dans mon livre les articles sur la NSA et sur l’Iran.
La réaction fut rapide. En l’espace de quelques minutes, Taubman se tenait près de mon bureau, l’air mécontent, exigeant de me parler. On alla dans son bureau. Il dit fermement que j’étais insubordonné et que je me révoltais contre les décisions éditoriales du Times.
« Mon point de vue était que vous et le Times étiez copropriétaires de l’article, que les principaux responsables de l’information, après mûre réflexion, avaient décidé de ne pas publier l’article et que vous n’aviez pas le droit unilatéral de le publier dans votre livre », a rappelé M. Taubman récemment. « À l’époque, je craignais que vous n’alliez de l’avant avec une décision hasardeuse que vous aviez prise en l’absence de consultation avec moi ou Bill. »
Taubman se souvient également qu’il était en colère parce qu’il pensait que je l’avais induit en erreur avant mon départ en congé pour écrire en lui laissant croire que j’allais écrire une biographie de George Tenet. Il a probablement raison.
Il voulait que je retire l’histoire de la NSA de mon livre. Je répondis que je voulais que l’histoire de la NSA soit publiée à la fois dans le Times et dans mon livre.
Nous recommençâmes à parler presque tous les jours de la façon de résoudre notre impasse. Au début, je suggérai au journal de publier l’histoire de la NSA quand mon livre serait sorti, dans le genre d’arrangement que le Washington Post semblait avoir avec Bob Woodward. Le Post publiait régulièrement des extraits des livres de Woodward sur sa page d’accueil, ce qui apportait au journal les scoops de Woodward en même temps qu’une formidable publicité à ses livres.
Cette proposition n’aboutit pas. Finalement, Taubman rétorqua que le journal n’envisagerait de publier l’article sur la NSA que si j’acceptais d’abord de le retirer de mon livre et de lui donner ainsi l’occasion de reconsidérer sa publication sans pression excessive. Mais je savais que la seule raison pour laquelle le Times envisageait même de publier l’histoire de la NSA était que je la laisserais dans mon livre.
Abramson déclara qu’elle avait dit à Keller que « ils auraient l’air d’imbéciles » s’ils retenaient encore l’histoire alors qu’elle serait apparue dans mon livre.
Nous étions à couteaux tirés, et le compte à rebours progressait pour la publication de janvier 2006 de State of War. Lorsque je rapportai à Lichtblau ce qui se passait, il plaisanta : « Ce n’est pas n’importe quel pistolet que tu leur mets sur la tempe. C’est un Uzi. »
En faisant des recherches pour ce récit personnel, j’ai été surpris d’apprendre qu’Abramson se souvient que le courriel que je lui avais adressé n’était pas ce qui avait déclenché un débat entre les rédacteurs en chef du Times sur ce qu’il fallait faire au sujet de l’histoire de la NSA et de mon livre. Abramson dit qu’au moment où je lui avait envoyé ce courriel, elle savait déjà que je mettais l’article sur la NSA dans mon livre. Elle dit qu’un autre journaliste du bureau de Washington lui avait dit plus tôt que j’allais le faire, et qu’elle avait déjà informé Bill Keller sur mes projets. Elle a déclaré qu’elle avait dit à Keller « qu’ils auraient l’air stupides » s’ils retenaient encore la publication de l’histoire alors qu’elle serait apparue dans mon livre. Abramson se rappelle lui avoir dit : « Le programme classifié sera connu publiquement quand le livre de Jim sera publié. Alors à quoi bon continuer de le retenir ? » « J’avais déjà révisé l’édition avec Keller une ou deux fois – peut-être plus », m’ a confié récemment Abramson. « Je voulais que l’histoire soit publiée ».
À part Éric Lichtblau, les principaux rédacteurs du Times, et moi-même, seuls quelques personnes au journal étions au courant de l’article sur la NSA ou du débat intense en cours sur la question de savoir s’il fallait le publier. Lichtblau et moi nous promenions parfois dans Farragut Square, juste à côté, quand nous voulions parler en toute confiance. Devant la plupart des autres journalistes et rédacteurs en chef du bureau, j’essayais de me comporter comme si rien d’inhabituel ne se passait, mais je suis sûr que certains soupçonnaient qu’il y avait quelque chose.
Cet automne-là, je craignais tellement que le Times ne publie pas l’histoire de la NSA et d’être viré que je pris rendez-vous avec un autre organe de presse national au sujet d’un emploi. Je dis à un rédacteur en chef que j’avais un article important que le Times avait refusé de publier sous la pression de la Maison-Blanche. Je ne dis rien au sujet de l’article, mais je dis que s’ils m’engageaient, je leur donnerais l’histoire. Le rédacteur en chef répondit que leur journal ne publierait jamais un article si la Maison-Blanche soulevait des objections pour des raisons de sécurité nationale. Je quittai cette réunion plus déprimé que jamais.
Après une longue série de conversations litigieuses qui ont duré plusieurs semaines à l’automne 2005, je trouvai finalement un compromis difficile avec les rédacteurs en chef. Ils laisseraient Lichtblau et moi recommencer à travailler sur l’affaire de la NSA, et le journal reprendrait les pourparlers avec l’administration Bush pour savoir s’ils pouvaient la publier. Mais si le journal décidait encore une fois de ne pas publier l’histoire, je devais la retirer de mon livre. J’acceptai ces conditions, mais je savais secrètement qu’il était déjà trop tard pour retirer le chapitre de mon livre, et je n’avais aucune intention de le faire. Je pariai que le Times publierait l’histoire avant la publication du livre. Mais je savais aussi que si les éditeurs ne le faisaient pas, je perdrais probablement mon emploi.
Curieusement, les rédacteurs en chef du Times semblèrent ignorer l’article sur l’Iran, même s’ils savaient qu’il serait aussi dans le livre. Peut-être que l’article sur la NSA était plus frais dans leur esprit. Nous n’eûmes pas de discussions significatives sur la question de savoir s’il fallait publier l’article sur l’Iran dans le journal, et les rédacteurs ne se sont jamais plaint de ma décision de le publier dans mon livre. (En 2014, Jill Abramson a dit dans une interview avec « 60 Minutes » qu’elle regrettait de n’avoir pas insisté davantage pour que le Times publie l’histoire CIA-Iran.)
Les rédacteurs en chef entamèrent une nouvelle série de réunions avec des responsables de l’administration Bush, qui étaient apparemment surpris que le Times ressuscite l’histoire de la NSA. Je fus exclu de ces conversations. Au cours de chacune des réunions au cours desquelles ils cherchèrent à convaincre les rédacteurs en chef de ne pas publier l’article, les responsables de l’administration Bush répétèrent à maintes reprises que le programme de la NSA était le joyau des programmes antiterroristes de la nation et qu’il épargnait des vies américaines en mettant fin aux attaques terroristes.
Les réunions traînèrent jusqu’ à l’automne 2005. Michael Hayden, qui est aujourd’hui le principal directeur adjoint du Bureau national du renseignement, a souvent pris les devants et a continué de rencontrer Philip Taubman. Au cours d’une réunion, Taubman et Bill Keller assistèrent à une séance d’information secrète au cours de laquelle des représentants officiels décrivirent les succès du programme antiterroriste. Mais quand les deux rédacteurs en chef revinrent au bureau de Washington, ils dirent à Lichtblau et moi que leur séance d’information avait été officieuse et tellement secrète qu’ils ne pouvaient pas partager ce qu’ils avaient entendu.
Lichtblau et moi nous rendîmes compte que les responsables de l’administration Bush avaient induit Keller et Taubman en erreur. Les fonctionnaires leur avaient dit qu’en vertu du programme d’espionnage domestique secret de la NSA, l’agence n’avait en fait pas écouté d’appels téléphoniques ni lu de courriels sans mandats approuvés par le tribunal.
Ils avaient insisté sur le fait que l’agence ne faisait qu’aspirer les métadonnées, en récupérant des traces d’appels téléphoniques et des adresses électroniques. Le contenu des appels téléphoniques et des courriels n’était pas surveillé, avaient déclaré les responsables aux rédacteurs en chef. Ce n’était pas vrai, mais le gouvernement avait essayé de convaincre Keller et Taubman que Lichtblau et moi avions exagéré la portée de l’histoire.
Cela prit du temps, mais Lichtblau et moi réussîmes finalement à persuader Keller et Taubman qu’ils avaient été trompés. Lors de notre récente entrevue, Keller a dit qu’une fois qu’il s’est rendu compte que l’administration avait été malhonnête avec lui, il a commencé à changer d’avis sur la publication de l’histoire.
Il était également d’une importance cruciale que Lichtblau ait développé une nouvelle source qui déclara que certains fonctionnaires de l’administration Bush avaient exprimé la crainte d’être poursuivis pour leur implication dans l’opération secrète d’espionnage de la NSA. Il y avait également eu un débat intense au plus haut niveau de l’administration Bush sur la légalité de certains aspects du programme. Cela souleva des questions fondamentales sur les garanties que les rédacteurs du Times avaient reçues de la part des représentants de l’administration au sujet du statut du programme.
Le fonctionnaire m’attira près de lui et chuchota si doucement qu’aucune des autres personnes dans la pièce ne pouvait entendre : « Vérifiez ce qui s’est passé quand Ashcroft est tombé malade. »
À la fin de l’automne 2005, je reçus également une piste importante d’une nouvelle source, mais le tuyau était tellement mystérieux que je ne savais pas quoi en penser à l’époque. Cela se produisit lorsqu’un haut fonctionnaire accepta de me voir, mais seulement à la condition que notre entrevue se déroule en présence d’autres fonctionnaires. Au cours de cette réunion, le fonctionnaire exprima à maintes reprises et haut et fort son ignorance totale de tout programme secret d’espionnage domestique de la NSA.
Mais alors que je m’en allais et que je me levais pour serrer des mains, le fonctionnaire m’approcha de près et chuchota, si doucement qu’aucun des autres dans la pièce ne pu entendre : « Vérifiez ce qui s’est passé quand Ashcroft est tombé malade. »
Lichtblau et moi nous sommes démenés pendant des semaines pour comprendre ce que ce tuyau signifiait.
Vers la fin de novembre 2005, Keller semblait être enclin à publier l’histoire de la NSA, mais les rédacteurs en chef avançaient si lentement que je commençai à craindre qu’ils ne se décident pas avant la parution de mon livre en janvier. Je n’avais jamais été aussi anxieux de ma vie. Je n’arrivais pas à dormir et je commençais à faire de l’hypertension. J’essayais de me distraire en allant au cinéma, mais j’étais tellement stressé que je quittais généralement la salle après cinq ou dix minutes. Je devais aussi continuer à rencontrer des sources clés sur l’histoire de la NSA pour les persuader de rester de mon côté et de ne pas rapporter l’histoire ailleurs. Je les exhortais à être patients, même si je manquais moi-même de patience. Lors des réunions sur l’article sur la NSA avec Lichtblau et Rebecca Corbett, j’étais tellement fatigué et stressé que je m’allongeais souvent et que je fermais les yeux sur le canapé du bureau de Corbett.
Alors que le temps passait et que la publication de mon livre approchait, Taubman me demanda d’organiser une nouvelle série de réunions avec les quelques dirigeants démocrates du Congrès qui connaissaient le programme de la NSA. Il voulait qu’ils lui disent que c’était bien de publier l’histoire. Lichtblau et moi fûmes troublés par cette demande.
Je rencontrai un démocrate qui accepta d’appeler Taubman, mais le membre du Congrès lui dit seulement que l’histoire était exacte, pas si le Times devrait la publier. Taubman en voulait plus, alors j’allai voir Nancy Pelosi, alors leader de la minorité parlementaire, qui était auparavant la démocrate classée au sein du House Intelligence Committee. Après qu’elle eut lu l’article, je lui demandai si elle appellerait Taubman. Sans confirmer l’histoire, elle dit seulement : « Le New York Times est une grande institution. Il peut prendre ses propres décisions. »
Puis, après une dernière série de réunions avec la Maison-Blanche début décembre, Keller déclara qu’il avait décidé de publier l’article. Il appela la Maison-Blanche et leur annonça sa décision. Le président Bush appela Arthur Sulzberger, l’éditeur du Times, et demanda une rencontre personnelle et une chance de convaincre Sulzberger de passer outre l’avis de Keller.
C’était intimidant, mais j’étais persuadé que Sulzberger verrait cela comme une chance de se montrer à la hauteur de l’héritage de son père, qui avait publié les documents du Pentagone face aux menaces de la Maison-Blanche de Nixon.
Sulzberger, Keller et Taubman se rendirent dans le Bureau ovale pour rencontrer Bush. Lichtblau et moi n’avions pas été invités à la réunion et nous n’avions même pas été autorisés à rencontrer Sulzberger pour lui exposer l’histoire au préalable.
Keller rapporta plus tard que Bush avait dit à Sulzberger qu’il aurait « du sang sur les mains » s’il publiait l’article sur la NSA. M. Keller déclara également que l’entrevue n’avait pas changé son point de vue ou celui de M. Sulzberger quant à la publication de l’histoire.
Keller et les autres rédacteurs commencèrent à exprimer leur assurance que l’article serait publié, mais il n’ y avait toujours pas de date de publication. En fait, la Maison-Blanche essayait de planifier d’autres réunions avec les rédacteurs en chef pour essayer une dernière fois de les faire changer d’avis. J’étais sur des charbons ardents ; c’était en décembre, mon livre sortait au début de janvier, et l’histoire n’était toujours pas parue dans le Times.
Enfin, Lichtblau arriva avec de nouvelles informations qui poussèrent le Times à publier l’article. Quelques jours seulement après la réunion du Bureau ovale de Bush-Sulzberger, une source avait déclaré à Lichtblau que la Maison-Blanche avait envisagé d’obtenir une injonction du tribunal pour empêcher le Times de publier l’article. C’était une nouvelle galvanisante, car la dernière fois que cela s’était produit au Times, c’était lors de l’affaire des Pentagon Papers dans les années 1970, un des événements les plus importants de l’histoire du journal. Le débat sur l’opportunité de publier l’histoire était clos. Cet après-midi-là, le papier était prêt à partir.
Mais il y eut une dernière chose : Keller ajouta une ligne à l’article, précisant que celui-ci avait été retenu pendant un an à la demande de l’administration Bush, qui avait prétendu que cela nuirait à la sécurité nationale. La version finale de l’article disait : « La Maison-Blanche a demandé au New York Times de ne pas publier cet article, arguant qu’il risquait de compromettre la poursuite des enquêtes et d’alerter les terroristes potentiels qu’ils risquaient de faire l’objet d’un examen minutieux. Après avoir rencontré des hauts fonctionnaires de l’administration pour entendre leurs préoccupations, le journal a retardé la publication d’un an pour faire des reportages supplémentaires. »
Nous avions un avantage par rapport au Times du début des années 1970 pendant la crise des Pentagon Papers, et c’était l’Internet. Il serait beaucoup plus difficile pour la Maison-Blanche d’aller devant les tribunaux pour arrêter la publication parce que nous pourrions rapidement mettre l’article en ligne. Peu de temps après que Keller eut appelé la Maison-Blanche pour leur dire que l’article était en cours de publication, celui-ci fut publié sur le site Web du New York Times. Il fit la une du journal le 16 décembre 2005.
Lichtblau, Corbett, Taubman et moi étions assis dans le bureau de Taubman, écoutant sur un haut-parleur pendant que Keller prenait la décision finale de publier l’histoire. Alors que l’appel avec Keller prenait fin, je poussai un long soupir. Taubman me regarda. « Qu’est-ce qui ne va pas ? » demanda-t-il.
« Rien. Je suis juste soulagé. »
Au cours des années qui ont suivi, Taubman a reconsidéré sa prise de décision sur l’histoire de la NSA, notamment en raison des divulgations de documents de la NSA par l’ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, qui ont révélé plus en détail l’ampleur de l’opération de surveillance nationale. Dans le sillage des révélations de Snowden, Taubman a déclaré à Sullivan, l’éditeur public, que ses vues avaient changé : « J’aurais pris une décision différente si j’avais su que Jim et Eric tiraient sur un fil qui défaisait toute une tapisserie ». (Ironiquement, le fait que le Times ait retenu l’histoire de la NSA pendant plus d’un an a convaincu Edward Snowden de ne pas venir au journal avec sa pile de documents lorsqu’il est devenu lanceur d’alerte.)
Aujourd’hui, Keller défend sa gestion de l’histoire de la NSA – tant en 2004 qu’en 2005 – et pense que l’un des facteurs a été le changement de climat dans le pays, qui s’était envenimé à cause de Bush, de la guerre en Irak et de la guerre contre le terrorisme. « Je suis assez à l’aise tant avec la décision de ne pas publier qu’avec la décision de publier », m’ a-t-il dit récemment.
Keller a décidé de ne donner à l’histoire qu’un titre en une seule colonne. Comme l’a écrit Lichtblau dans son livre, « Keller avait décidé qu’il ne voulait pas qu’on ait l’air de donner un coup de poing dans l’œil de la Maison-Blanche avec un gros titre criard sur l’espionnage de la NSA ; nous voulions être discrets, a-t-il dit, et l’article parlerait pour lui-même. »
Je me fichais de l’absence d’un titre en bannière. Ma partie de quitte ou double avec le Times était terminée, et j’avais l’impression d’avoir gagné.

Le procureur général sortant John Ashcroft surveille une garde d’honneur dans le Grand Hall du ministère de la Justice à Washington le 10 décembre 2004. Photo: Pablo Martinez Monsivais/AP
4. LA GUERRE À LA PRESSE
L’impact de l’histoire fut immédiat et explosif. George W. Bush fut forcé de confirmer l’existence du programme, alors même qu’il appelait la fuite d’informations à son sujet un « acte honteux ». L’administration ordonna rapidement une enquête, qui fut remise à un grand jury. Bientôt, des équipes d’agents du FBI essayaient de retrouver nos sources.
Le Congrès était indigné que l’administration Bush ait caché le programme de la NSA à tout le monde, sauf à une poignée de hauts représentants du Congrès. L’article fut diffusé le jour où le Sénat devait se prononcer sur la ré-autorisation du Patriot Act. En disant que le programme de la NSA constituait une parodie du Patriot Act, les législateurs forcèrent le report du vote. Les républicains comme les démocrates promirent une enquête du Congrès sur le programme de la NSA.
Lichtblau et moi nous démenâmes pour continuer avec d’autres articles, dont un basé sur le conseil étrange que j’avais reçu pour vérifier ce qui s’était passé quand Ashcroft était malade. Nous avons appris que c’était une référence à une rébellion secrète contre le programme de la NSA par Comey et d’autres hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, qui avait été déclenchée lors d’une confrontation avec la Maison-Blanche dans la chambre d’hôpital d’Ashcroft en mars 2004.
Après un embargo prépublication exceptionnellement strict, [certains éditeurs peuvent se réserver une période d’exclusivité de la diffusion en exigeant une période d’embargo avant diffusion en archive ouverte, NdT] State of War fut publié dans la première semaine de janvier 2006, mais pas avant que l’administration Bush ait tenté d’intervenir. Dans son livre de 2014, Company Man : Thirty Years of Controversy and Crisis in the CIA, l’ancien avocat de la CIA John Rizzo décrit comment il a reçu un appel paniqué d’un membre du personnel du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche le jour de l’an disant qu’il pourrait être nécessaire d’essayer d’arrêter la publication de mon livre.
Un ancien agent de la CIA se souvient que les directeurs de son unité avaient averti les employés de ne pas lire State of War ; ce faisant, on leur avait dit que ce serait comme commettre une trahison.
Ce soir-là, Harriet Miers, alors conseillère juridique de la Maison-Blanche, appela Rizzo, lui suggérant d’appeler Sumner Redstone, président de Viacom, pour qu’il empêche la publication du livre chez Simon et Schuster. Rizzo dit qu’il a décidé de ne pas passer l’appel. Jack Romanos, directeur général de Simon and Schuster à l’époque, m’a dit que d’autres fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement avaient également appelé, voulant voir le livre avant sa publication. Simon et Schuster avait refusé.
Après sa sortie, la CIA fut très furieuse au sujet du livre ; un ancien officier de la CIA se souvient que les directeurs de son unité avaient averti les employés qu’il ne fallait pas lire State of War, ce qui, leur a-t-on dit, reviendrait à une trahison.
Je fis une série d’entrevues télévisées pour faire connaître le livre. Grâce à la ligne dans l’article du Times sur la NSA disant que l’article avait été retenu pendant un an à la demande de l’administration Bush, l’intrigue qui se cachait derrière l’article était bien sûr un sujet brûlant. Mais chaque fois qu’on me posait des questions à ce sujet, je disais simplement que le Times avait rendu un service public en publiant l’article, ajoutant que je n’entrerais pas dans les détails des délibérations internes du journal. Je voulais maintenir l’attention sur la substance de l’histoire elle-même. Les intervieweurs n’ont pas toujours été satisfaits. Après une conversation avec Katie Couric à l’émission « Today », je dis discrètement à Katie Couric que je regrettais de ne pas avoir pu répondre à sa question. « Ouais, c’est des conneries », répondit-elle.
Le Times a également refusé d’expliquer sa décision de retenir le reportage, de faire obstruction aux journalistes et même au rédacteur public du journal. « L’explication donnée par le New York Times au sujet de sa décision de signaler, après un retard d’un an, que l’Agence de sécurité nationale écoutait aux portes des citoyens sans mandat approuvé par le tribunal était terriblement inadéquate », a écrit le rédacteur public du Times Byron Calame au début de 2006. « Et j’ai eu des difficultés inhabituelles à obtenir une meilleure explication pour les lecteurs, malgré les promesses répétées du journal d’une plus grande transparence. Pour la première fois depuis que je suis devenue rédacteur public, le rédacteur en chef et l’éditeur ont refusé de répondre à mes demandes d’information sur la prise de décisions liées aux nouvelles. »
Quelques semaines plus tard, je découvris que la hiérarchie du Times avait prêté une attention particulière à ce que j’avais dit lors de ma tournée de promotion du livre au sujet la prise de décision du journal. Lichtblau, Taubman et moi fûmes invités à faire une présentation spéciale au conseil d’administration du Times au sujet de l’article sur la NSA. Au déjeuner, un des membres du conseil d’administration se pencha vers moi et me dit discrètement qu’ils étaient très reconnaissants de la façon dont je m’étais comporté à la télévision.
Lichtblau et moi remportâmes un prix Pulitzer pour nos articles sur la NSA. Lorsque le Times remporte un Pulitzer, le travail dans la salle de rédaction principale de New York s’arrête à 15 heures le jour de l’annonce officielle des prix et les lauréats prononcent de brefs discours devant l’ensemble du personnel.
Quand ce fut mon tour, je me levai et je regardai l’assemblée. Je me sentais mal à l’aise, je ne savais pas quoi dire. Pendant des mois, j’avais secrètement vécu avec la peur d’être congédié pour insubordination ; maintenant, j’étais honoré pour la même chose, par les mêmes personnes. Je décidai de laisser cette question de côté pour la journée. J’ai regardé Keller et Sulzberger et j’ai dit : « Eh bien, merci. Vous autres savez ce qui s’est passé, à quel point cela a été difficile. »
Pendant ce temps, les répercussions politiques et juridiques de l’article sur la NSA n’étaient pas les mêmes que celles de toute autre histoire que j’avais jamais traitée, et elles continuèrent à se multiplier. L’histoire donna rapidement lieu à des protestations et des auditions du Congrès, à des poursuites judiciaires contre le gouvernement et les entreprises de télécommunications, et des appels à la création d’une nouvelle commission Church.
Craignant que les vannes des enquêtes soient sur le point de s’ouvrir, l’administration Bush lança une campagne agressive pour contrer les critiques croissantes. En janvier 2006, elle publia un « livre blanc » exposant ses arguments en faveur de la légalité du programme et, dans les coulisses, elle commença à faire pression sur les principaux membres du Congrès pour qu’ils arrêtent les demandes d’une enquête de grande ampleur du Congrès. Mais la Maison-Blanche savait que le programme de la NSA était sur un terrain glissant, surtout après qu’un juge fédéral eut pris parti pour l’American Civil Liberties Union dans un procès et déclaré le programme inconstitutionnel.
La fureur de la Maison-Blanche contre le New York Times pour avoir publié l’histoire s’intensifia. En mai, Gonzales déclara à ABC [American Broadcasting Company, NdT] que le gouvernement pouvait poursuivre les journalistes pour avoir publié des informations classifiées. Il pensait clairement à nous en disant cela.
« Il y a quelques dispositions dans les textes qui, si vous êtes attentifs à la formulation, semblent indiquer que c’est une possibilité », dit Gonzales.

Le sénateur Tom Cotton, Républicain-Arkansas, membre de la commission du renseignement du Sénat, arrive pour une réunion à huis clos dans l’immeuble Hart des bureaux du Sénat, à Capitol Hill, en 2017. Photo : Chip Somodevilla/Getty Images
Lichtblau et moi avions désormais beaucoup de sources prêtes à parler, et nous découvrîmes rapidement que la CIA espionnait les dossiers bancaires privés de milliers d’Américains et d’autres personnes à travers le système bancaire SWIFT. L’accès secret à SWIFT signifiait que la CIA pouvait suivre les transactions bancaires des Américains et d’autres personnes sans l’approbation du tribunal.
Lichtblau avait surnommé une source « Death Wish » [pulsion de mort, NdT] parce qu’au cours de chaque entrevue, il disait qu’il ne pouvait pas parler de l’opération SWIFT et qu’il se mettait à en parler ensuite.
Cette fois-ci, Lichtblau prit les devants et fut beaucoup plus combatif que moi sur cette histoire. J’étais épuisé par la lutte pour l’article sur la NSA, et je n’étais pas sûr d’être prêt pour une autre bataille avec le gouvernement au sujet de la publication. J’ai commencé à perdre mon sang-froid, suggérant en privé à Lichtblau que nous devrions retarder l’histoire sur le SWIFT. Comme je paniquais un peu, je songeai même à retirer ma signature de l’article.
Heureusement, Lichtblau m’a appelé. Je me suis vite remis de mon malaise, et nous avons fini l’article.
Les rédacteurs du Times, certainement embarrassés par la façon dont ils avaient traité l’histoire de la NSA, nous poussaient maintenant agressivement à faire l’article sur SWIFT et d’autres. L’administration Bush ne fit qu’un effort timide pour bloquer l’article sur SWIFT. Le secrétaire au Trésor, John Snow, demanda à Keller de ne pas le publier, et quelques autres fonctionnaires sont intervenus, mais ce fut à peu près tout.
Pourtant, c’est après la publication de l’article sur SWIFT en juin 2006 que les véritables attaques contre nous ont commencé, dirigées par des conservateurs au Congrès et dans tout le pays qui nous accusaient d’être des criminels récidivistes nuisant à la sécurité nationale.
Lorsque mes avocats téléphonèrent au ministère de la Justice, les procureurs refusèrent de leur assurer que je ne faisais pas « l’objet » de leur enquête. C’était une mauvaise nouvelle.
Lichtblau et moi avions fait face à une tempête de critiques après l’histoire de la NSA. Des groupes d’extrême droite organisèrent des campagnes de publipostage haineux contre nous et organisèrent des manifestations petites mais bruyantes à l’extérieur du bureau de Washington et du bâtiment du Times à New York.
Des experts conservateurs et des membres du Congrès se présentèrent à la télévision pour demander que Keller, Lichtblau et moi soyons punis. Tom Cotton, alors officier de l’armée en Irak, écrivit une lettre au Times disant que Lichtblau, Keller et moi devrions être emprisonnés pour atteinte à la sécurité nationale. Le Times ne publia pas la lettre, mais elle fut reprise dans le cyberespace de droite de l’époque, et Cotton accéda à la gloire dans les cercles conservateurs en conséquence. Il a ensuite été élu au Sénat comme républicain de l’Arkansas et pourrait bientôt être nommé directeur de la CIA.
Notre notoriété fit aussi apparaître des théoriciens de la conspiration et des gens qui prétendaient que le gouvernement les poursuivait. De retour au bureau de Washington un jour après le déjeuner, je vis un homme seul debout sur le trottoir devant l’entrée du bâtiment, tenant une pancarte disant qu’il était harcelé par le gouvernement. « Bonjour James », dit-il comme je m’approchais. « Je vous attendais. »
Plus inquiétant, l’administration Bush avait maintenant lancé deux grandes enquêtes importantes sur des fuites : l’une sur l’affaire de la NSA dans le New York Times, et l’autre sur l’affaire de l’Iran que j’avais incluse dans State of War. En travaillant avec les grands jurys fédéraux d’Alexandria, les agents du FBI commençaient à interroger des gens que je connaissais.
Puis il y eut une longue accalmie, qui a duré plus d’un an. Je pensais que le gouvernement avait décidé de ne rien faire.
Mais en août 2007, je découvris que le gouvernement ne m’avait pas oublié. Penny m’appela pour me dire qu’une enveloppe de FedEx était arrivée du ministère de la Justice. Il s’agissait d’une lettre dans laquelle on disait que le MJ menait une enquête criminelle sur « la divulgation non autorisée de renseignements classifiés » dans State of War. La lettre avait apparemment été envoyée pour satisfaire aux exigences des lignes directrices internes du ministère de la Justice qui énoncent comment les procureurs devraient procéder avant de délivrer des assignations à comparaître aux journalistes pour témoigner dans des affaires criminelles.
De toute évidence, l’administration Bush avait pris la décision stratégique de ne pas s’en prendre au New York Times pour nos articles sur la NSA. Apparemment, ils ne voulaient pas d’un affrontement constitutionnel avec le journal. Donc, au lieu de cela, ils me poursuivaient pour ce que j’avais écrit dans mon livre. J’ai réalisai qu’ils essayaient de m’isoler du Times. J’ai appris plus tard que le ministère de la Justice et le FBI avaient enquêté sur un large éventail d’informations contenues dans plusieurs chapitres de mon livre avant de s’intéresser au le chapitre qui incluait l’affaire CIA-Iran.
Simon et Schuster acceptèrent de payer pour ma défense jusqu’en 2011, date à laquelle mes avocats, Joel Kurtzberg et David Kelley de Cahill Gordon & Reindel, ont accepté de continuer à s’occuper de l’affaire à titre gracieux. Le New York Times n’a pas réglé mes frais juridiques.
Lorsque mes avocats téléphonèrent au ministère de la Justice à propos de la lettre que j’avais reçue, les procureurs refusèrent de leur donner l’assurance que je ne faisais pas « l’objet » de leur enquête. C’était une mauvaise nouvelle. Si j’étais considéré comme un « témoin assisté », plutôt qu’un simple témoin, cela signifiait que le gouvernement n’avait pas exclu la possibilité de me poursuivre pour avoir publié des renseignements classifiés ou d’autres infractions présumées.
En janvier 2008, le ministère de la Justice m’assigna à témoigner devant un grand jury fédéral. Je refusai de m’y conformer, et mes avocats demandèrent l’annulation de l’assignation.

L’ancien agent de la CIA Jeffrey Sterling quitte le palais de justice fédéral d’Alexandria le 26 janvier 2015, à Alexandria, en Virginie. Photo : Kevin Wolf/AP
Pendant ce temps, le gouvernement avait commencé une enquête approfondie et secrète pour essayer d’identifier mes sources. Plusieurs personnes assignées à témoigner devant le grand jury me dirent que les procureurs leur avaient montré les relevés des appels téléphoniques entre nous et avaient exigé de savoir demandé de quoi on parlait. Le gouvernement révéla finalement qu’ils ne s’étaient pas procuré mes relevés téléphoniques, mais qu’ils s’étaient procuré les enregistrements des personnes avec qui j’étais en contact. Le gouvernement obtint mes relevés de crédit, ma carte de crédit et mes relevés bancaires, ainsi que les relevés d’hôtels et de vols de mes voyages. Ils ont aussi surveillé mes transactions financières avec mes enfants, y compris l’argent que j’ai viré à un de mes fils pendant qu’il étudiait en Europe.
L’un des pires plans du gouvernement pour me cibler n’était pas directement lié à l’enquête sur la fuite de State of War. Mais apparemment, il était à l’étude en même temps que je combattais les efforts du gouvernement pour me forcer à témoigner.
J’ai obtenu la preuve qu’un agent du FBI discutait de plans pour tendre une embuscade lors d’une entrevue que le FBI pensait être sur le point de se tenir entre une source et moi en 2014. Les preuves montrent que le plan d’embuscade avait été examiné par des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, qui ont insisté pour que le FBI s’assure que je ne serais pas présent lorsqu’ils arrêteraient ma source au moment du rendez-vous. Les éléments de preuve révèlent également que le FBI planifiait des moyens de retarder ou de détourner l’entrevue à la dernière minute afin qu’ils puissent arrêter la source en mon absence.
Aucune réunion de ce genre ne se fit, donc l’embuscade planifiée par le FBI n’eut jamais lieu. Mais lorsqu’on m’a plus tard parlé du plan du FBI, cela m’a fait réaliser à quel point j’étais devenu un centre d’intérêt pour les enquêteurs du gouvernement. Le FBI a refusé de commenter.
Dans un autre incident plus récent qui me donna un aperçu effrayant du pouvoir de la surveillance gouvernementale, je rencontrai une source sensible et bien placée par le biais d’un intermédiaire. Après la rencontre, qui a eu lieu il y a quelques années en Europe, je commençai à faire des recherches sur la source. Une heure plus tard, je reçus un appel de l’intermédiaire qui me dit : « Arrêtez de chercher son nom sur Google. »
En janvier 2008, après que j’eus reçu la première assignation à comparaître relative à l’affaire CIA-Iran dans State of War, une série de motions de procédure prolongeaient la lutte pour savoir si je devais témoigner devant le grand jury jusqu’après l’élection présidentielle de 2008.
Je pensais que l’élection de Barack Obama mettrait fin à l’affaire. La juge de district des États-Unis Leonie Brinkema semblait le penser aussi. En juillet 2009, elle rendit une brève décision notant que le grand jury dans l’affaire avait expiré, ce qui signifiait que mon assignation n’était plus valide. Je fus surpris lorsque le ministère de la Justice d’Obama se hâta de dire à Brinkema qu’il voulait renouveler la citation à comparaître.
Rétrospectivement, c’était l’un des premiers signaux indiquant qu’Obama était déterminé à prolonger et même à étendre bon nombre des politiques de sécurité nationale de Bush, y compris une répression contre les lanceurs d’alerte et la presse. Au mépris des conséquences possibles sur la démocratie américaine, l’administration Obama a commencé à surveiller de manière agressive les communications numériques des journalistes et des sources potentielles, ce qui a entraîné plus de poursuites pour fuites que toutes les administrations précédentes réunies.
Mon affaire traîna ensuite pendant quelques années. Elle avançait lentement parce que chaque fois que l’administration me poursuivait par une motion de procédure ou une nouvelle assignation, Brinkema se rangeait de mon côté. Ses décisions en ma faveur ont empêché que je sois forcé de témoigner devant le grand jury.
Je pensais que l’administration comprendrait le message de Brinkema et abandonnerait l’affaire. Au lieu de cela, l’administration Obama poursuivit Jeffrey Sterling, l’ancien officier de la CIA, pour avoir prétendument divulgué des informations utilisées dans l’affaire CIA-Iran.

Le procureur général des États-Unis Eric Holder le 4 décembre 2014, à Cleveland, dans l’Ohio. Photo : Angelo Merendino/Getty Images
Sterling fut mis en examen en décembre 2010 et arrêté en janvier 2011. Le ministère de la Justice m’assigna à nouveau, cette fois pour témoigner à son procès.
Brinkema annula aussi cette assignation à comparaître ; encore une fois, je croyais que j’étais tiré d’affaire. Mais quelques jours seulement avant le début du procès, le ministère de la Justice interjeta appel. Les procureurs de l’administration Obama déclarèrent à la cour d’appel que la décision de Brinkema devrait être annulée parce qu’il n’y avait pas de privilège du journaliste dans une affaire pénale. La cour d’appel accepta cet argument, outrepassant Brinkema et m’ordonnant de témoigner.
La raison d’être du gouvernement a transformé mon cas en épreuve de force contre la liberté de la presse aux États-Unis. Je sentais que je n’avais pas d’autre choix que de faire appel devant la Cour suprême. Certains avocats des médias de l’extérieur dirent clairement qu’ils ne voulaient pas que je le fasse parce que cela pourrait mener à une mauvaise décision de la part d’une majorité conservatrice.
Ce débat devint sans objet en 2014, lorsque la Cour suprême refusa de se saisir de l’affaire. Cela permit à la décision de la cour d’appel de rester en vigueur, laissant la destruction légale du privilège d’un journaliste dans le 4ème circuit comme héritage du Premier Amendement d’Obama. [La cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit est une cour d’appel fédérale américaine, devant laquelle sont interjetés les appels en provenance de neuf cours de district, NdT]
Mais la victoire juridique historique du gouvernement a coûté cher à l’administration et en particulier au procureur général d’Obama, Eric Holder. Pendant des années, mes avocats et moi avions mené notre campagne juridique la plupart du temps seuls sans tambour ni trompette, mais alors que l’affaire atteignait son paroxysme, la couverture médiatique et la publicité atteignirent un point culminant.
Avec la flambée soudaine de l’attention des médias, Holder se trouva davantage sous pression, et il commença finalement à reculer. Il déclara que tant qu’il serait procureur général, aucun journaliste n’irait en prison pour avoir fait son travail. Il modifia également les lignes directrices du ministère de la Justice qui définissent à quel moment le gouvernement pourrait chercher à contraindre les journalistes à témoigner dans le cadre d’enquêtes sur les fuites. (On s’attend à présent largement à ce que le ministère de la Justice de Donald Trump affaiblisse ces lignes directrices, ce qui facilitera la poursuite des journalistes.)
Mais même si Holder faisait des déclarations publiques conciliantes, les procureurs fédéraux directement impliqués dans mon cas continuaient de se battre avec acharnement. À un moment donné, Holder a laissé entendre que le ministère de la Justice et moi allions conclure un accord, alors qu’en fait, les procureurs et mes avocats n’avaient pas du tout négocié d’accord. Derrière les coulisses, il semblait y avoir une guerre entre Holder et les procureurs, qui étaient en colère parce qu’ils avaient l’impression qu’Holder les court-circuitait. Les procureurs avaient répété à plusieurs reprises au tribunal qu’ils avaient besoin de mon témoignage pour plaider contre Sterling. Holder, après avoir soutenu leur approche agressive pendant des années, avait soudainement changé de cap sous la pression du public. J’étais pris au milieu.
Enfin, à la fin de 2014, nous vîmes les premiers signes d’un assouplissement de la position des procureurs. Ils ont exigèrent ma comparution à l’audience préliminaire de janvier 2015 à Alexandria pour déterminer la portée de mon éventuel témoignage au procès de Sterling. Mais contrairement aux citations à comparaître précédentes, cette nouvelle personne sollicita mon témoignage limité et n’exigea pas que j’identifie des sources confidentielles.
Puis, alors que je me trouvais dans la salle de conférence avec mes avocats en attendant le début de l’audience, les procureurs lancèrent une offensive de dernière minute. Ils me dirent qu’ils voulaient que j’intervienne à la barre des témoins et que je précise quels passages de mon livre étaient fondés sur des renseignements classifiés et des sources confidentielles. J’ai refusé.

James Risen, au centre, quitte le palais de justice fédéral d’Alexandria, Virginie, le 5 janvier 2015. Photo : Cliff Owen/AP
Quand je fus appelé à la barre lors de l’audience de 2015, j’eus du mal contenir ma frustration et mon dégoût. « Je ne vais pas fournir au gouvernement les informations dont il semble vouloir se servir pour créer une mosaïque afin de prouver ou réfuter certains faits », ai-je dit à Brinkema.
Le procureur principal, James Trump (pas de lien apparent avec Donald), ne demanda pas qui étaient mes sources ni ce qu’elles m’avaient dit. Au lieu de cela, il me demanda encore une fois si je refuserais d’identifier mes sources, même si cela signifiait aller en prison.
Je lui dis que c’était ce que je ferais.
Trump se tourna ensuite vers des questions auxquelles j’avais déjà répondu dans les documents déposés devant les tribunaux, en me demandant si j’avais effectivement utilisé des sources confidentielles et en essayant de confirmer que j’avais parlé à Sterling pour un article non apparenté du New York Times de 2002. Il voulait que j’ y réponde à haute voix, en audience publique.
J’ai me montrai provocant et je refusai de répondre aux questions essentielles.
Brinkema commença à perdre patience avec moi. Je demandai une pause pour parler à mes avocats.
Je suis retourné à la barre des témoins et j’ai répondu à quelques questions de routine. Trump a vite annoncé qu’il n’avait plus rien pour moi. Finalement, les procureurs avaient fait marche arrière et suivi les instructions de Holder.
C’était fini, presque avant que je m’en rende compte. Je suis sorti de la cour et je suis rentré directement chez moi.
Je crois que ma volonté de combattre le gouvernement pendant sept ans pourrait faire en sorte que les procureurs soient moins désireux de forcer d’autres journalistes à témoigner au sujet de leurs sources. Dans le même temps, l’administration Obama a utilisé mon cas pour détruire les fondements juridiques du privilège du journaliste dans le 4ème circuit, ce qui signifie que si le gouvernement décide de s’en prendre à un plus grand nombre de journalistes, ceux-ci auront moins de protections juridiques en Virginie et au Maryland, où se trouvent le Pentagone, la CIA et la NSA, et donc où de nombreuses enquêtes sur les fuites liées à la sécurité nationale seront menées. Il sera ainsi plus facile pour Donald Trump et les présidents qui le suivront de mener une attaque encore plus draconienne contre la liberté de la presse aux États-Unis.
Les batailles entourant les reportages sur la sécurité nationale au cours des années qui ont suivi le 11 septembre 2001 ont donné des résultats mitigés. À mon avis, les médias grand public n’ont pas tiré les principales leçons de la débâcle entourant les rapports sur les ADM avant la guerre en Irak. Judy Miller, journaliste du Times, est devenue un bouc émissaire facile, peut-être parce qu’elle était une femme dans le domaine du journalisme sur la sécurité nationale, un domaine dominé par les hommes. En se concentrant sur elle, il était plus facile pour tout le monde d’oublier à quel point les reportages imparfaits d’avant-guerre étaient répandus dans presque tous les grands médias. « Ils voulaient une cible commode, quelqu’un à blâmer », me disait récemment Miller. Le parti pris anti-féminin « en faisait partie ». Elle signale qu’un chapitre de son mémoire de 2015, The Story : A Reporter’s Journey [« L’Article : le voyage d’un journaliste »], s’intitule Scapegoat [« Le bouc émissaire »].
Depuis lors, je crois que le Times, le Washington Post et d’autres organes de presse nationaux ont parfois fait du matraquage sur les menaces liées au terrorisme et aux armes de destruction massive. Les reportages exagérés sur le terrorisme, en particulier, ont eu un impact politique majeur aux États-Unis et ont contribué à clore le débat à Washington sur la question de savoir s’il convenait de réduire considérablement certains des programmes antiterroristes les plus draconiens, comme l’espionnage de la NSA.
Mais dans l’ensemble, je crois que la lutte au sein du Times au sujet de l’article sur la NSA a contribué à inaugurer une nouvelle ère de reportages plus offensifs sur la sécurité nationale au journal. Depuis, le Times a été beaucoup plus enclin à tenir tête au gouvernement et à refuser d’accepter les demandes de la Maison-Blanche de retenir ou de supprimer des articles.
Le plus honteux dans toute cette affaire est que Jeffrey Sterling a été reconnu coupable et condamné à 42 mois de prison.
Source : The Intercept, James Risen, 03-01-2018
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source.
Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s'arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]Nous ne sommes nullement engagés par les propos que l'auteur aurait pu tenir par ailleurs - et encore moins par ceux qu'il pourrait tenir dans le futur. Merci cependant de nous signaler par le formulaire de contact toute information concernant l'auteur qui pourrait nuire à sa réputation.







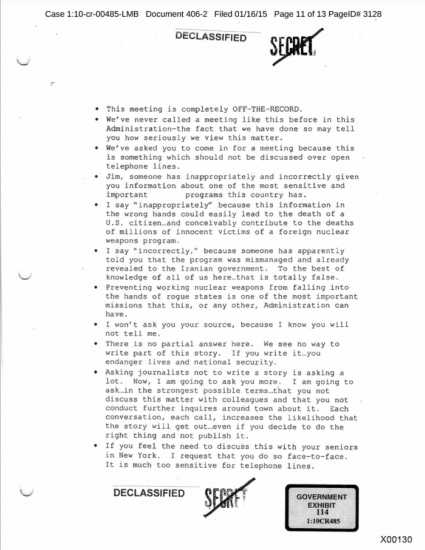











Commentaire recommandé
J’ai éprouvé quelques difficultés à entrer dans le scénario. C’est lourd, chronophage, presque indigeste. Mais édifiant.
Puis:
«Nous sommes un empire à présent, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous essayez d’étudier la réalité –peut-être même avec succès–, nous agissons encore, créant d’autres nouvelles réalités, que vous pourrez également étudier, et c’est ainsi que les choses avanceront. Nous sommes les acteurs de l’histoire… et vous, vous tous, il ne vous reste plus qu’à étudier ce que nous faisons.»
Voilà comment ils occupent, détournent, un grand nombre de cerveaux brillants, aux coeurs valeureux, en laissant fuiter des informations choisies et quelques notions d’angoisse. Garder un coup d’avance en les scotchant dans » l’histoire ».
Là où c’est pathétique, c’est lorsqu’on mesure que ce gaspillage de temps, d’énergie, de ressources, de puissance et surtout de vie ne sert qu’une réalité cauchemardesque, dégénérative et auto- destructrice.
Certes, ils sont un empire. Quelle honte !
24 réactions et commentaires
Passionnant, merci pour la traduction ! James Risen doit s’arracher les cheveux devant le film « The Post », tiens.
+7
AlerterOui c’est passionnant, il est très rare de lire un tel témoignage, cela donne un éclairage très important et utile du contexte de l’époque entourant ces révélations ainsi que des ficelles et des jeux d’ombre des métiers de l’information. Cela sera sans doute un document précieux pour les historiens.
+5
Alerter« The post », film de propagande pur jus pour tenter de redorer le blason du NYT et du WaPo, ces « journaux » devenus des médias de propagande « progressiste-mondialiste-néocon » et dont la crédibilité est, c’est rassurant, en perdition.
+8
AlerterJe conseille humblement le livre de Suzanne Lindauer (ex-agente de la CIA, DIA) pour avoir un avis éclairé de l’intérieur sur la relation Pouvoir- Service Secret…bref le pouvoir profond en action et les luttes internes de ce pouvoir sur le sujet précis de la guerre en Irak de 2003 avec pour toile de fond le 11/09.
« Extrême préjudice » aux éditions 20 coeurs.
+7
AlerterOn attend un « intercept » français… même si on sait que le site a été créé par un des financiers du changement de régime en Ukraine.
Ils font du bon boulot sur certains sujets, ils en évitent d’autres…
+3
AlerterPour signaler aussi un organisme nouveau utilisant la pointe du virtuel, le réel étant parfois décevant…
« forensic architecture »
https://twitter.com/VICEfr/status/975695883743318016
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela ressemble à un bellingcat 3.0… la vidéo commence par une une révélation d’un mensonge sur des meurtres de masse volontairement commis par les US, un crime de guerre ordinaire et un mensonge médiatique, sans conséquence circulez go back shopping.
Puis l’outil est expliqué… développé par une université… à Londres et financé par l’UE… on se demande ce que viennent faire ces gens dans la dénonciation des crimes de guerre des US… et on a la réponse avec la 2ème partie, la modélisation imaginée d’un des pires endroits de la planète… la prison syrienne de Sednaya dont ce site a parlé dernièrement… ils ont même « recréé les sons »… le truc indispensable…
+2
Alerteret … difficile à croire mais VICE le site qui a fait le sujet se décrit comme, deux points ouvrez les guillemets
« Le guide ultime de la connaissance »
Il y a vraiment des tarés sur internet…
+2
AlerterJ’ai éprouvé quelques difficultés à entrer dans le scénario. C’est lourd, chronophage, presque indigeste. Mais édifiant.
Puis:
«Nous sommes un empire à présent, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous essayez d’étudier la réalité –peut-être même avec succès–, nous agissons encore, créant d’autres nouvelles réalités, que vous pourrez également étudier, et c’est ainsi que les choses avanceront. Nous sommes les acteurs de l’histoire… et vous, vous tous, il ne vous reste plus qu’à étudier ce que nous faisons.»
Voilà comment ils occupent, détournent, un grand nombre de cerveaux brillants, aux coeurs valeureux, en laissant fuiter des informations choisies et quelques notions d’angoisse. Garder un coup d’avance en les scotchant dans » l’histoire ».
Là où c’est pathétique, c’est lorsqu’on mesure que ce gaspillage de temps, d’énergie, de ressources, de puissance et surtout de vie ne sert qu’une réalité cauchemardesque, dégénérative et auto- destructrice.
Certes, ils sont un empire. Quelle honte !
+18
AlerterMais non, c’est juste l’humanité. 🙂
J’ai lu passionnément toute cette histoire. Mais ce n’est pas « l’affaire politique » ni même la « question de la Légalité et du Droit » qui est intéressante, mais la confirmation, si besoin était, que les plus significatives comme les moins signifiantes décisions ne sont le résultat que de l’affect.
Par exemple, est ce que tout le monde ce rend bien compte que toute cette histoire de tribunal est un « jeu » entre Juge et Procureurs. Le sujet est totalement secondaire. Les conséquences probable s totalement ignorées. C’est juste un vernis sur le meuble, qui est lui le rapport de force personnel ou institutionnel que les acteurs entretiennent.
De même toutes ces fuites, tous ces gens qui veulent parler. Pour des grands principes? Sinon par dépit, frustration et vanité…
Combien de décisions/actions qui ont modifié le cours de l’histoire ont pour origine un simple dérangement intestinal..? 🙂
C’est pourquoi plus que jamais, il ne faut attribuer au complot ou à la volonté ce que la bêtise explique parfaitement.
Et pour le dépit sur la/les Valeur/s de l’Empire: plus c’est grand, plus c’est puissant, plus c’est bordélique… 😉
+5
AlerterUn peu confus votre commentaire 😉
Mais je vous rejoins sur ce que je crois comprendre de vos propos; affectif et transit digestif…
Cependant, en évitant trop de circonvolutions autour des diptères, pensez-vous que la vache, de sa queue alerte, fera mouche ?
Cela ne vous paraît pas bizarre que ce soit aux journalistes de faire des enquêtes alors qu’il me paraîtrait bien plus évident que ce soit le rôle d’un procureur ou d’un juge d’instruction ?
Le véritable problème n’a jamais étais une difficulté du transit intestinal, mais ce qu’on fait passer dedans, un peu comme discerner la cause et l’effet 🙂
À force d’avaler des couleuvres, les vessies deviennent des lanternes, les bébés zumain deviennent moutons, les journalistes des guignols, les juges des vigipirates, et moi et moi et moi. Mais prout quoi !!!
C’est dit en filigrane, le gars c’est fait mener en bateau à l’insu de son plein gré volontaire.L’enquête est rondement menée mais bien gardée au chaud un an. Bush fait le job et passe le relais à Baraque à frites qui le passe à Trumpette qui le passera à… Une nana ?
C’est dans l’ordre des choses. Les puissants rivalisent dans une créativité pathétique et les gueux s’effarouchent d’illusions, sourds à tout entendement. C’est triste!
Mais plus rien ne m’étonne 🙁
https://youtu.be/vqmUkjZhYOM
+5
AlerterTout ça c’était pour dire que les affaires du Monde, de tout le monde, avancent comme elles peuvent sans grand contrôle réel sur ce qui se passe, chacun étant d’abord préoccupé par les trivialités de son quotidien personnel.
Transposez ce que vous vivez dans votre famille à l’échelle des États et vous avez une parfaite image de ce qui se passe en réel… 🙂
+1
AlerterLa solution est dans le problème. Il suffirait que nous écrivions nos propres scénarios et que nous nous y tenions.
+0
AlerterC’est presque le sujet:
La » Fake news » du moment peut être mise à jour dans le grand d silence des médias :
Les scientifiques anglais du laboratoire de guerre chimique refusent d’accréditer la version officielle….
https://www.zerohedge.com/news/2018-03-19/porton-down-scientists-under-extreme-pressure-confirm-nerve-gas-russian
+10
AlerterJ’attends de la Vérité qu’elle m’affranchisse… De toute cette boue. Des pays, des villes des hommes par milliers sont détruits pour qui ? Pour quoi ? Je veux une réponse.
+4
AlerterArticle au long cours, instructif et quelque part glaçant. Merci aux traducteurs.
Autres sources qui exposent la fabrication de l’info :
– Journaliste Chris Hedges/CIA/NYT : http://arretsurinfo.ch/les-elites-nont-plus-aucune-credibilite/
– Un monde en péril (Chomsky) : http://arretsurinfo.ch/un-monde-en-peril/
– Autre côté de la planète (vidéo) : »Le gouvernement est le premier vecteur de fake news » : https://arretsurinfo.ch/un-specialiste-balance-tout-sur-les-manipulations-de-letat-concernant-les-fakes-news/
+5
AlerterROui, c’est glaçant. Et merci pour les liens. Tien, rechauffons l’atmosphère 😉
« Dis-moi oui, dis-moi non
Dis-moi oui ou non
Mais j’t’en prie, ne m’laisse pas
Dans cet embarras
Est-ce oui, est-ce non ?
Si c’est oui, c’est bon
Si c’est non, j’m’évanouis
Alors, dis-moi oui
Ah! oui, ce serait si gentil, oui!
Ah! non, ce s’serait pas mignon, non!
Oui, oui, oui, ah! oui
Ah! non! non non , non, non, non
Non non non non non non non !
Ah! oui, oui! »
Et pour le fun…
https://youtu.be/0tVFvJcyhzg
+1
AlerterMalheureusement arretsurinfo.ch arrêté (pour raison de santé officiellement) depuis février 2018.
Cependant ça reste une mine d’information comme pour cet article par exemple :
https://arretsurinfo.ch/cette-revolution-syrienne-qui-nexiste-pas/
Toutes les références aux Times sont exactes avec des articles encore en ligne.
Feu arrêtsurinfo était très réactif sur l’actualité au Moyen-Orient avec diverses sources.
Mais il reste plusieurs milliers d’articles ainsi que des vidéos toujours disponibles …
+2
AlerterIl y avait déjà eu un précédent. Et puis c’était reparti … Allez savoir.
+0
Alerterexcellent reportage et mille merci pour le gros travail de traduction.
La révélation du billet, c’est effectivement de montrer au grand jour l’acharnement du Gtv contre le journalisme d’investigation sur des sujets dont la teneur est l’illégalité des actions gouvernementale. En l’occurrence, l’espionnage des masses civiles et les assauts criminels contre des états tiers.
Le métier de journaliste apparait soumit à des pressions dont la menace est constante, qui accepterait une vie où le respect d’un travail bien fait est synonyme de tracas administratifs répétés sur soit et sur sa famille et avec en couperet un emprisonnement ?
Cela permet aussi de distinguer le « journaliste » de la direction du journal, qui inquiète autant que le Gvt.
Nul besoin de s’étonner après, que les Crises soit visé par des officines de collaboration avec des intérêts nullement avouables, tels les décodeurs et Cie. Pas besoin d’une barbouze pour nous dissuader d’exister, les chiens de garde savent-faire du haut de leur mégaphone médiatique….
+6
AlerterIl est aussi un bon rappel dans ce billet que c’est sous les mandats d’Obama – soi-disant un démocrate – que les lanceurs d’alerte ont été les plus poursuivis par la « Justice ».
Concernant l’affaire actuelle dont le NYT et le WaPo se repaissent, càd le « russiagate », le rapport de Michael Horowitz, du DOJ, est impatiemment attendu ces jours-ci, notamment pour ses conclusions sur les autorisations de la FISA obtenues pour espionner l’entourage de Trump.
+3
AlerterOui et c’est à relier au noyautage du parti démocrate par les services de renseignement :
https://www.wsws.org/fr/articles/2018/03/14/demo-m14.html
Petit rappel utile dans cet article : “Rejoindre la CIA ou les forces spéciales des Army Rangers ou les Navy SEALs, c’est comme rejoindre la Mafia : personne ne s’en va jamais ; ils passent juste à de nouvelles affectations.“
+1
AlerterD’accord pour les félicitations 🙂
Pas d’accord pour les conclusions. 🙂
Ce n’est pas « Le Gouvernement », » Les Officines » qui engagent des actions, ce sont des PERSONNES.
C’est une erreur de suivre la présentation faites par ces personnes de leurs actions. Cette manière de présenter a pour but de dissuader les individus (citoyens) que nous sommes de discuter du bien fondé des actions entreprises et d’agir pour les contrecarrer.
Individuellement, chacun de ces acteurs, prenant des décisions émotionnelles qui nous affectent, sont aussi fragiles que nous.
Globaliser leurs actions, alors qu’elles ne le sont pas en fait, nous interdit d’agir. La politique des Pouvoirs est de présenter leurs actes comme un tout et de dénier la cohésion qui pourrait ressortir des actes des individus.
Donc prendre le parti de rendre directement responsable celui qui fait, ou dit, à chaque fois, en l’empêchant de se cacher derrière « l’institution ».
Ne pas laisser le principe de « Diviser pour régner » aux mains de ceux qui règnent déjà. 🙂
+7
AlerterSi le début de l’article peine un peu, reflétant la confusion psychologique désormais si « américaine » pour qui les faits en général comptent moins que le discours sur les faits, en revanche la seconde partie est passionnante! Courage d’un individu certes, mais aussi exposé clair des interférences permanentes du pouvoir sur les médias. Quand je pense que l’on a ironisé sur les révélations de Udo Ulfkotte. Là, les CIA, NSA etc.. ont quasiment leurs bureaux dans les rédactions. Ils décident, oui ça ça va, non ça ça plairait pas. Sous le couvert d’une dangerosité totalement inventée, factice, n’ayant pas une once de crédibilité. D’un autre côté, Risen n’a qu’un argument, le « droit de savoir ». C’est maigre, fragile.
+0
AlerterJ’ai perdu toute illusion sur les USA après le coup d’état de Dallas du 22/11/1963.
Le complexe bancaro-militaro-industriel avait gagné.
+0
AlerterLes commentaires sont fermés.