A propos du livre de Mme Claudia Moatti : Res Publica
Les débats sur la souveraineté révélés par les évolutions des représentations de la Res Publica
Madame Claudia Moatti, professeure à Paris-8 est spécialiste de l’histoire intellectuelle, est une personnalité reconnue du monde universitaire français. Elle vient de publier un ouvrage sur l’évolution de la conception de la « chose publique », de la res publica dans le monde romain[1]. Cet ouvrage fera certainement référence. Il traite non seulement des interprétations de la notion de « chose publique », mais aussi des notions de légitimité et de droit. Derrière tout cela, nous avons bien entendu la question de la souveraineté.
Il s’agit d’un ouvrage très solidement appuyé sur des références nombreuses et précises, mais qui jamais ne viennent troubler l’immense plaisir, et l’immense intérêt, que l’on prend à se lecture. Car, cet ouvrage peut être lu tant par le spécialiste et l’érudit, que par le citoyen qui porte un intérêt aux choses publiques. Cet ouvrage nous plonge dans la vie publique romaine, des origines jusqu’à l’Empire, vers la fin du IVème siècle de notre ère. Il nous emmène dans les temps troublés de la fin de la République, dans les luttes sociales et politiques qui marquent les périodes des Gracques et de Sylla. Il nous fait cotoyer des auteurs célèbres, comme Cicéron, Suétone, Tite-Live ou Dion Cassius. Cet ouvrage cependant s’inscrit dans une logique explorée par Madame Moatti depuis de nombreuses années. Son analyse de la pensée cicéronienne, et de sa justification du senatus consulte ultime, acte d’une extrême gravité renvoie à des travaux antérieurs[2]. De même, les passages qui s’interrogent sur le leg des auteurs de la fin de la République (le Ier siècle avant notre ère) sont la poursuite de travaux eux-aussi antérieurs[3]. C’est dire que ce livre représente une forme d’aboutissement de travaux qui s’étalent sur de nombreuses années. Il répond aussi à un autre ouvrage, publié sous la direction de Claudia Moatti et de Michelle Riot-Sarcey Pourquoi se référer au passé[4].
Il porte en lui une question : comment se fait-il que nous déclinions toujours le passé au présent ? Car, les références, tant aux termes qu’aux notions issues du monde romain, sont multiples et constantes dans la vie politique. Mais, ces déclinaisons sont elles fidèles à ce que ces notions pouvaient représenter dans le monde romain. Au-delà, il eut il une représentation unique de ces notions à Rome, ou bien ces notions ne furent-elles pas plutôt l’objet de rivalités et d’interprétations contradictoires ? N’étant pas personnellement un spécialiste de l’histoire romaine, même si j’en connais ce que mes professeurs de Lycée se sont efforcés de faire entrer dans ma tête (dure), c’est donc bien sur l’histoire de ces dites notions, et sur leur pertinence dans le contexte actuel, que portera plutôt cette recension.
Les enjeux d’un livre
Claudia Moatti commence par poser une question qui reste aujourd’hui plus que jamais d’une très grande pertinence. Elle écrit ainsi dans son introduction : « Philosophes et historiens du ‘républicanisme’ ont pourtant cherché dans l’Antiquité l’origine fondatrice. De Leonardo Bruni à Machiavel ou Bodin, de Rousseau, Babeuf, Condorcet aux fédéralistes américains, le modèle romain dit ‘républicain’ a été diversement interprété et a donné naissance à une multiplicité d’interprétations »[5]. C’est une évidence. Nous sommes tous, très largement, que ce soit consciemment ou à notre insu, héritiers en matière politique et en matière du droit des usages et des institutions de cette période, même si cet héritage est aussi largement un détournement de sens[6]. On ne convoque pas impunément le passé au présent. Pourtant, en dépit de l’anachronisme, la comparaison est lourde de sens. Dans son petit livre publié en 2002, l’historien britannique Fergus Millar, posait d’ailleurs fort bien cette question[7]. Alors, qu’est-ce qui fait notre intérêt ? Ici encore je laisse la parole à Claudia Moatti : « Pourquoi une ancienne société fondamentalement inégalitaire et ses idéaux aristocratiques gardent jusqu’à aujourd’hui encore une telle force d’attraction pour ceux qui tentent de penser la liberté républicaine? Pourquoi donc le détour par l’antique s’impose-t-il de manière aussi insistante? »[8].
Il y a probablement une raison principale dans cette force d’attraction, une raison qui est permanente depuis la Révolution de 1789 jusqu’à nos jours : l’idée que ce qui se joue en permanence dans la politique c’est l’affrontement entre le peuple et une couche dominante, qu’on l’appelle oligarchie ou aristocratie. C’est pourquoi le sort tragique de Tiberius Gracchus, puis celui de son frère, Caius Gracchus, continue de nous parler[9]. C’est pourquoi nous pouvons aussi nous retrouver dans la lutte implacable des populares, les partisans du peuple, contre les optimates, les partisans du Sénat, dans les personnages de Marius et de Sylla. Ce dernier nous est aussi familier par un vers de Victor Hugo, tiré du poème Ultima Verba qui fut publié dans Les Chatiments en 1853 :
« Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ; »
Et ce n’est pas pour rien si le nom de Sylla détourna le mot de « dictature » de son ancienne signification, où ce mot désignait une magistrature exceptionnelle, mais prévue dans le cadre de la République, pour devenir un synonyme de Tyrannie[10]. Même dans la culture populaire, l’histoire de la fin de la République et du passage à l’Empire reste vivace, comme en témoigne le succès de la série des films « Star Wars »[11].
Parmi les autres raisons, il faut certainement compter avec la longue tradition de continuité (réelle ou mythifiée) dans le droit français, mais aussi dans les structures institutionnelles. Enfin, il y a aussi le monde des représentations. Les acteurs du jeu politique, et ce fut vrai de la Révolution française au début du XXème siècle, parce que le latin et la culture romaine faisaient partie de l’éducation, se représentaient en acteurs justement de l’histoire romaine. Oui, l’histoire romaine joue un rôle important dans notre culture politique, et ceci n’en rend que plus dommage l’abandon de l’enseignement du latin au Collège (à partir de la classe de 5ème) qu’avait décidé Mme Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre de l’Education nationale sous le quinquennat de François Hollande.
Qu’est-ce que la res publica ?
Le premier point sur lequel ce livre est celui de la définition de la « chose publique ». Claudia Moatti a recours à Cicéron dont elle produit une citation[12] : « tout peuple qui sur tel rassemblement d’une multitude (…) toute cité qui est l’organisation du peuple ; toute res publica qui est comme je l’ai dit la chose du peuple, doit être dirigée par un conseil pour pouvoir durer »[13]. Ce qui est ici important est la manière dont Cicéron hiérarchise le passage de la « multitude » au peuple, par l’existence d’intérêts communs, puis présente la Cité comme cadre organisateur de ce « peuple ». Claudia Moatti souligne le côté remarquable du texte de Cicéron par sa tentative de clarification[14]. Elle rappelle alors, que la « Cité » ne désigne pas une simple ville (oppidum) mais qu’elle décrit le cadre dans lequel s’organise un « peuple » de citoyens, un peuple dont la présence est obligatoire pour rendre la justice[15], tout comme pour édicter des lois. La citoyenneté est ici une notion fondamentale. Appartenir au « peuple romain », c’est avoir le droit d’agir en interaction avec les autres citoyens sur le territoire de la « Cité ». Ce sont donc les citoyens qui constituent la « Cité » [16]. La res publica ne se pense donc qu’en relation avec le « peuple ». Elle définit les relations et les conflits au sein de ce « peuple ». De ce point de vue, c’est bien l’égalité juridique des citoyens, cette égalité que l’on retrouve dans la formule archaïque populus plebsque qui est centrale. Avec cette égalité juridique, le « peuple » prend réellement un sens politique et se constitue comme acteur de la politique[17]. Il est alors important de conserver en mémoire qu’aux temps premiers de la République le peuple romain est à la fois un acteur dans la cité et une entité pour les relations entre la cité et l’étranger[18]. Retenons ici cette distinction importante qui confirme la centralité de la relation interne/externe. Il ne peut donc y avoir de relations politiques et juridiques, de conflits aussi autour de ces relations, qu’au sein d’une entité souveraine et distincte des autres. La notion de souveraineté est donc primordiale mais aussi centrale à l’existence de la res publica. Mais, cette « chose publique » ne peut se constituer qu’à travers l’égalité juridique des citoyens qui leur assure (ou doit leur assurer) un droit égal à la participation politique, aux choix dans la vie de la « Cité »[19].
De fait, Cicéron, dans son ouvrage De Officis, analyse le pluralité des possibles forme d’organisation, qu’elles soient liées à la naissance ou la langue. Mais, pour lui, la forme décisive est bien celle qui unit les citoyens. Cette forme n’est pas simplement descriptive mais elle définit une société politique[20], et c’est en cela qu’une « Cité » n’est pas une ville, un simple oppidum. Il faut donc tenir compte des deux niveaux de raisonnement. Pour une simple description, on peut procéder de l’ascendance vers la langue. Mais, pour l’analyse qui doit nécessairement avoir une dimension dynamique, seul compte le concept de citoyen, formant un peuple dans le cadre d’une cité politique. La notion de « peuple » est donc principalement politique et non ethnique[21]. Il faut donc comprendre ce qui constitue un « peuple ». Quand nous parlons d’un « peuple » nous ne parlons pas d’une communauté ethnique ou religieuse, mais de cette communauté politique d’individus rassemblés qui prend son avenir en mains[22], du moins aux origines de la République. Le « peuple » auquel on se réfère est un peuple « pour soi », qui se construit dans l’action et non un peuple « en soi », ce qui ne serait qu’une « multitude ». Se référer à cette notion de souveraineté, vouloir la défendre et la faire vivre, se définir donc comme souverainiste, implique de comprendre que nous vivons dans des sociétés hétérogènes et que l’unité de ces dernières se construit, et se construit avant tout politiquement. Cette unité n’est jamais donnée ni naturelle[23].
Pourtant, cette définition va évoluer avec les conflits sociaux que Romme connaitra, en particulier à partir du IIème siècle avant notre ère. Se fera jour, alors, une définition bien plus conservatrice de « l’intérêt commun », dont Cicéron est largement le codificateur[24].
Le rôle du conflit social dans la vie de la cité et dans la construction de la « chose publique »
Cette transformation de la notion de la « chose publique » que décrit abondamment Claudia Moatti découle des conflits nombreux dont l’histoire de la république romaine résonne[25]. Mais, ces conflits furent aussi un mécanisme de construction des institutions de cette même république[26]. Elle note ainsi que les sécessions de la Plèbe au début de la République permirent de limiter le pouvoir de l’aristocratie, de modérer les aspects les plus inégalitaires de la République originelle et ouvrirent peu à peu de nouveaux espaces de libertés publiques[27]. De fait les membres de la Plèbe furent autorisés à se présenter à la Questure en -409, aux magistratures équestres en – 368, à se faire élire comme censeur en – 351 et comme préteur en -336[28].
Elle ajoute alors : « Ainsi l’analyse en terme de partes repose sur une vision plurielle et ouverte de la cité, dont l’unité est constamment en construction… »[29]. De fait, le conflit y est une part du jeu politique ; c’est lui qui « construit » la res publica. Ce conflit va se poursuivre à travers l’opposition entre ceux que l’on appelle les populares ou représentants du parti « du peuple » et les optimates qui sont les représentants de l’élite sénatoriale[30]. L’enjeu social et économique des terres confisquées aux vaincus, terres qui constituent l’ager publicus, devient dès lors central[31]. De fait, à cette époque, l’absence ou l’imprécision du cadastre rend possibles les abus des plus riches[32]. De ce déséquilibre économique et sociale est issu la volonté, à chaque incident plus claire, du Sénat de s’accaparer la souveraineté et l’initiative des lois[33]. Ces conflits trouvent leur origine dans les conséquences sociales de la IIème Guerre Punique (contre Carthage) mais aussi celles provenant de l’expansion de Rome. Le passage de la petite propriété foncière aux grandes exploitations dont la main-d’œuvre est essentiellement composée d’esclaves, mais aussi l’accaparement des terres publiques par l’aristocratie, créent une situation intenable[34] Mais, à ce conflit qui est « interne » à l’espace politique romain vient s’ajouter celui lié à la longue, et difficile, intégration des « italiens », ces membres des tribus soumises puis alliées de Rome, mais auxquels cette même Rome dénia, pendant longtemps, la citoyenneté[35].
Les conflits sont donc légitimes, à condition qu’ils puissent déboucher sur des compromis permettant de les dépasser. Telle était d’ailleurs la fameuse remarque faite par Guizot sur l’histoire des institutions qui caractérisait la « civilisation européenne » en 1828[36]. Dans sa septième leçon, il analyse le processus d’affranchissement des communes, ce qui le conduit d’ailleurs à la célèbre conclusion que voici : « (…) la lutte, au lieu de devenir un principe d’immobilité, a été une cause de progrès ; les rapports des diverses classes entre elles, la nécessité où elles se sont trouvées de se combattre et de se céder tour à tour, la variété de leurs intérêts et de leurs passions, le besoin de se vaincre sans pouvoir en venir à bout, de là est sorti peut être le plus énergique, le plus fécond principe de développement de la civilisation européenne[37]. » Cette idée que le conflit est un facteur de développement, de construction des institutions, fut d’ailleurs reprise par Commons qui travaillait sur les luttes des petits paysans américains face aux grandes compagnies[38]. Cette idée correspond aujourd’hui à l’un des points les plus importants de la théorie institutionnaliste. Il est ici dommage que Claudia Moatti n’ait pas fait référence dans son livre aux auteurs qui lui auraient permis de dresser un parallèle éclairant sur cette question.
Deux visions de la « chose publique »
Cette res publica va donc donner lieu, au travers des conflits, à deux représentations antagoniques. Il y a celle qui voit en la res publica l’ensemble des affaires politiques issues des interactions entre les citoyens et il y a celle qui voit en la res publica une forme, la « grande affaire »[39]. Cette tendance à une idéalisation de la res publica conduit donc à prétendre son indivisibilité et à proclamer que le conflit est nécessairement néfaste[40]. Mais, le problème ne réside pas seulement dans une fétichisation de la res publica à laquelle répond une réification du peuple. Elle se concrétise dans deux visions opposées des magistrats, mais aussi – implicitement – en deux visions de l’exercice de la souveraineté[41]. Claudia Moatti montre bien comment la définition d’un espace politique homogène et stable correspond à l’idéologie des élites sénatoriales qui se refusent à tout compromis et qui s’engagent progressivement, à partir de l’épisode des Gracques (-135 à – 123) dans une escalade de la violence[42]. Alors que la première vision, celle marquée par l’assimilation de la res publica en l’ensemble des affaires politiques concernant les citoyens, pose que les magistrats et le Sénat sont in potestas populi ou sous le pouvoir du peuple[43], la seconde vision se représente les magistrats comme recevant la potestas du peuple pour le diriger[44]. De fait, plus le réel sera dévasté par les conflits internes et marqué par un raidissement de l’élite sénatoriale qui se refuse désormais à tout compromis, plus on tendra à la construction d’une res publica idéale et bien ordonné d’où tout conflit est exclu[45].
C’est principalement Cicéron qui sera à la fois le représentant et l’acteur de cette transformation. Il va élaborer, au fil de ses œuvres, la res publica comme une entité abstraite et non plus comme la somme des interactions par lesquelles les citoyens définissent des intérêts communs[46]. Dans le même temps, Cicéron va construire un discours dans lequel les magistrats représentent un « peuple » juridique mais qui n’est plus un peuple social[47]. Le double processus de fétichisation de la chose publique et de réification du peuple est ainsi achevé. Cela le conduit à considérer que tous ceux qui s’élèvent contre le Sénat sont des « séditieux » et qu’il faut mener contre eux une guerre à outrance[48]. Le vocabulaire de la guerre emplit alors l’espace civique. Il utilise dans De re publica la métaphore de la tutelle[49], une métaphore qu’il reprendra dans De officis[50]. Le peuple est donc considéré comme le fils mineur du Sénat, dans un parallèle avec le droit privé et dans une référence aux pouvoirs du paterfamilias romain. Mais un autre parallèle vient alors à l’esprit. Dans ce « peuple » mis en tutelle par l’élite sénatoriale on peut retrouver comme un écho lointain de la volonté de mise en tutelle du peuple actuel par « ceux qui savent », à la condition que ces derniers fassent preuve de « pédagogie ». Le parallèle est d’autant plus tentant que, peu à peu, les décisions du peuple sont contestées voire révoquées, comme ce fut le cas avec le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne qui suivit en 2007. Mais, là où Cicéron usait d’une métaphore juridique, qui restait d’une certaine mesure dans le champs du politique, car le droit est aussi une expression du politique, aujourd’hui l’oligarchie utilise l’extension d’une légitimité scientifique (ou plus exactement pseudo-scientifique) dans un domaine où elle n’a rien à faire[51]. De cela, pour revenir au livre de Claudia Moatti et à Rome, il en découle une vision de la liberté entre inégaux qui rompt justement avec l’égalité juridique proclamée entre les citoyens[52]. C’est donc bien une vision du pacte civique très différente du pacte démocratique.
Qui, du peuple ou du Sénat, détient la souveraineté ?
On ne peut donc plus esquiver cette question : qui détient réellement la souveraineté. C’est une question qui, elle aussi, se pose aujourd’hui. Pourtant, aux origines de la république romaine la question semblait tranchée. Mario Bretone montre que la volonté du peuple (iussum populi) s’affirmait à travers l’élection de magistrats (les questeurs) dès l’époque royale[53]. Cette question devient cependant centrale dans les débats politiques du IIème siècle avant notre ère[54]. La question, et Claudia Moatti le rappelle[55], fut posé lors de l’élection de Scipion Emilien au consulat, alors qu’il se présentait en réalité à l’édilité. Le peuple pouvait-il s’affranchir de la Lex villia annalis qui fixait le cursus honorum ? De fait, le peuple était dit « maître des comices » autrement dit maître de l’ordre du jour des assemblées populaires[56]. Le concept de la « souveraineté populaire », que certains tiennent pour « inventé » par la Révolution française, existait donc à Rome, et se traduisait par un contrôle populaire sur les magistrats[57]. Il y avait donc bel et bien un discours établissant la primauté du « peuple », comme dans les cas où c’est le « peuple » qui décide qu’un homme peut être élu à des fonctions plus hautes que celles qu’ils briguait.
Une partie de conflits tournent donc autour de la responsabilité politique des magistrats[58]. La question centrale n’est pas seulement l’émergence d’une responsabilité politique du magistrat aux côtés de sa responsabilité privée, mais bien qui pouvait mettre en question cette responsabilité politique[59]. Or, le passage de la responsabilité morale à la responsabilité politique du magistrat[60] est l’un des enjeux du bras de fer entre le peuple et le Sénat au sujet de la souveraineté[61]. Ce point est important car il établit la nécessaire séparation entre la sphère privée et la sphère publique. Le magistrat en tant que délégataire de la souveraineté du peuple peut être ainsi relevé de sa responsabilité privée et soumis à une appréciation politique de ses actes. Cependant, seule la défense de la res publica peut être invoquée à la décharge d’un magistrat[62]. L’importance de ce point vient de ce qu’il établit la primauté du politique. C’est, ici encore, un débat qui a aujourd’hui des échos évidents. Claudia Moatti explique alors ce qui se joue dans le débat sur la responsabilité politique des magistrats, et surtout devant qui ils sont responsables[63]. De fait, si la responsabilité politique n’exclut pas toute responsabilité « privée », on constate que la res publica est en surplomb des règles normales[64].
A cette tradition de la souveraineté du peuple s’oppose la tentative d’appropriation de la souveraineté par le Sénat. Cette tentative d’appropriation passe par la « sanctification » de la res publica[65]. De fait, dans le quatrième chapitre du livre, intitulé la « chose du Sénat », Claudia Moatti montre bien comment cette souveraineté du peuple va être capturée puis appropriée par les élites sénatoriales.
Une histoire pleine de bruits et de fureur
On entre alors dans ces « temps des troubles » qui vont du IIème siècle avant notre ère jusqu’à l’établissement de l’Empire. Ce sont des temps de guerre civile, ce sont des temps d’une extrême cruauté. En émerge tout d’abord la figure des « dictateurs ». Contrairement à ce que laisse à penser l’usage commun du terme, le dictateur est un magistrat, qui peut être désigné par les deux consuls ou élu par le peuple. Initialement, sa fonction était soit de parer à une urgence militaire (et ce fut le cas pour Fabius cunctator ou « Le temporisateur » durant la seconde guerre Punique face à Hannibal) soit d’arriver à un compromis antre les factions opposées dans le cadre des conflits qui marquaient la vie politique de la république. Mais, dès le IIème siècle, les dictateurs vont être dirigés contre la plèbe[66]. Cela deviendra parfaitement évident dans la dictature de Cornellio Sylla, qui fait l’objet du troisième chapitre du livre de Claudia Moatti. Dans ce qu’elle appelle un « moment Syllanien »[67], elle remarque cependant que la dictature de Sylla fut bien établie conformément à une loi.
Mais, cette dictature, marquée par des actes terribles et cruels, qui furent exercés tant contre les citoyens romains que contre les « alliés », et qui laissèrent un souvenir épouvantable dans la mémoire des romains[68], participe d’une moment d’autonomisation de l’Etat[69] qui se constitue alors en surplomb de la société politique afin de préserver les intérêts des plus riches. Mais, ces mêmes optimates durent aussi se plier à la férule du dictateur. La dictature de Sylla dépassa en ampleur et en pouvoirs les dictatures précédentes[70], parce qu’elle devait justement établir un pouvoir en surplomb sur les classes sociales pour imposer la suprématie de l’élite sénatoriale[71]. Pour ce faire le « dictateur », qui est un magistrat de la République et dont la « dictature » est issue d’une loi d’investiture[72], il convient de ne jamais l’oublier, se mue en tyran[73]. Dès lors, on entre dans un système où le « peuple » est dépossédé de fait de la souveraineté, qui est attribuée au Sénat. Ce dernier devient le seul maître de ce qui est licite et de ce qui ne l’est, capable de désigner qui est un « subversif » et qui ne l’est pas. Les magistratures populaires, comme les tribuns de la Plèbe dépérissent[74].
Il n’y a pas que les citoyens romains qui souffrirent de cette dictature, par une forme de légalisation de l’état d’urgence qui se traduisit par l’affaiblissement de l’égalité juridique des citoyens[75]. Elle transforma aussi radicalement, comme le montre justement Claudia Moatti, les relations entre « romains » et « italiens »[76]. De fait, la dictature se Sylla envoie ce message qui est congruent aux attentes des élites sénatoriales : la res publica est unifiée et non plus le produit de conflits. Désormais apparaît la figure du « bon citoyen », celui qui soutient sans arrière-pensée cette res publica fétichisée[77]. On comprend à la fois pourquoi cette « dictature » était nécessaire aux élites, mais aussi la torsion qu’elle induit dans l’histoire de la République. A travers la fétichisation de la res publica se joue le triomphe des élites sur le peuple mais aussi la congélation des institutions républicaines qui, faute de pouvoir se nourrir de conflits, n’évolueront plus de manière relativement consensuelle.
La violence extrême de cette période vient couronner celle du Sénat lors de la Guerre Civile et avant, lors de l’épisode des Gracques. Mais, cette violence qui perdurera, car désormais elle devient le seul instrument de régulation des conflits sociaux marque l’extension des pouvoirs du sénat dans le domaine militaire avec la pratique du Senatus Consulte Ultime, mais aussi dans le domaine de l’invalidation des lois[78]. La période de la dictature de Sylla, et plus généralement la période qui va du IIème siècle avant notre ère à la fin de la république marque bien un tournant tant dans la politique que dans les représentations.
Continuités et discontinuités impériales
Entre le moment où César se fit accorder la dictature à vie, et la victoire d’Octave à Actium (-31) se déroulent les derniers soubresauts de la mort de la République[79]. Pourtant, Octave va restituer certains des pouvoirs que les trois triumvirs (Marc-Antoine, Lepide et Octave lui-même) s’étaient attribués en -43. Il procèdera à une épuration du Sénat, déjà mis à mal par les importantes proscriptions de -43, puis réunira la Sénat en janvier -27 en déclarant « remettre les affaires publiques à la décision du Sénat et du peuple romain ». César usait d’une formule quelque peu différente avant son assassinat, demandant que l’on s’en remette au peuple[80].
Ce faisant, Octave-Auguste n’abandonne pas le pouvoir[81]. Mais, comme le note Claudia Moatti, il s’inscrit du moins par le langage dans une certaine forme de continuité avec la république[82]. Octave, désormais renommé Auguste, va d’ailleurs reprendre des réformes inspirées par celle de César, qui apparaît comme le dernier des populares et procéder à une intégration des italiens ainsi qu’à une réforme sociale. Ses pouvoirs correspondent à ceux d’un consul et d’un tribun (sur les plans civils et militaires) mais sans précision géographique (ce qui était le cas sous la République) ni limitation de durée[83]. Toutes les charges sont en théorie votée par le peuple. Cela renforce l’idée que l’Empereur est un délégataire de la souveraineté populaire, mais qu’il ne l’a pas abolie[84]. Bien entendu, ceci fait partie des représentations qu’Auguste cherche à mettre en avant et à imposer. Il se présente comme celui qui a remis la res publica entre les mains du Sénat et du peuple[85], et celui qui a aboli certaines des mesures prises du temps du triumvirat[86]. Pour couronner ce retour à la paix civile, il codifie l’emploi de la formule SPQR (Senatus PopulusQue Romanum)[87], qui inverse cependant la formule utilisée par Cicéron (Populus SenatuQue). Cette formule se retrouve dans les Philippiques[88], suite de discours polémiques et de combat prononcés ou écrit contre Marc-Antoine (et qui seront probablement la cause de la proscription et de la mort de Cicéron en -43). Il convient de remarquer que, pour Cicéron, le peuple a délégué sa souveraineté au Sénat, comme le montre la métaphore de la « mise en tutelle » que l’on a déjà évoquée. S’il y a continuité, ou apparence de continuité sur ce point, c’est bien avec la représentation conservatrice de la fin de la République.
Mais, cette continuité est cependant présente. Ici encore, donnons la parole à Claudia Moatti : « L’idée de continuité ne devient explicite et n’est exploitée que lorsque se pose un problème de légitimité politique »[89]. Le lien entre la légitimité et la souveraineté est ici évident[90]. Claudia Moatti constate qu’Auguste a un besoin pressant de légitimité, et ce besoin, il ne peut l’assouvir qu’en reprenant, ne serait-ce que de manière formelle, l’idée que la souveraineté appartient au peuple, et que ce peuple la lui a déléguée.
On revient ici à cette idée de la délégation. On présente souvent les empereurs romains comme des souverains tout puissants. C’est oublier un peu vite d’où leur vient la souveraineté. Ainsi, dans la loi d’investiture de Vespasien (69-79 de notre ère), la Lex de imperio Vespasiani, la ratification des actes de l’empereur avant son investiture formelle est dite « comme si tout avait été accompli au nom du peuple » [91]. On perçoit que l’origine de la souveraineté réside dans le peuple, même si ce dernier en a délégué l’exercice à l’empereur. On peut assurément relever la présence dans cette loi d’investiture d’une clause discrétionnaire, qui autorise l’empereur à agir « hors des lois » dans l’intérêt et pour la majesté de l’État. Mais on peut aussi considérer cela comme une première formulation de l’état d’exception. D’ailleurs Paolo Frezza parle de la « potestas nouvelle et extraordinaire » de l’empereur[92].
Bretone lui oppose cependant le sens profond de cette clause discrétionnaire, qui peut être l’origine d’un pouvoir autocratique[93], et conclut : « la subordination du souverain à l’ordre légal est volontaire, seule sa ‘majesté’ pouvant lui faire ressentir comme une obligation un tel choix, qui demeure libre » [94]. De fait, l’empereur réunit dans ses mains tant la potestas que l’auctoritas[95]. S’y ajoute l’imperium, que détenaient avant lui les magistrats républicains. On pourrait croire que cela clôt le débat, une subordination volontaire n’étant pas une subordination. Mais, la phrase de Bretone, quand il écrit, « seule sa ‘majesté’ pouvant lui faire ressentir comme une obligation », invite à réflexion. Elle peut signifier qu’un empereur qui violerait les lois existantes pour son seul « bon plaisir » et non dans l’intérêt de l’État, perdrait alors la « majesté » (maiesta) qui accompagne l’imperium. Dans ce cas son assassinat deviendrait licite car le « dictateur » se serait mué en « tyran ». Et l’on sait que nombre d’empereurs sont morts assassinés, ou ont été contraints de se suicider. L’empereur est donc un dictateur, au sens romain du terme, qui peut s’affranchir de la légalité si nécessaire pour le bien de l’État et du « peuple » dans ce que l’on appelle des cas d’extremus necesitatis [96], mais il ne dispose pas de ce pouvoir de manière « libre » comme le dit Bretone. Il doit en justifier l’usage, quitte à se faire assassiner.
De fait, on constate que d’auguste au IIIème siècle de notre ère, il y a une continuité de l’usage des mots de la République[97]. Ce n’est pas une simple fiction impériale, même si se développe en province un sentiment monarchique contre le Sénat romain[98], et cela ne se résume pas à une forme d’hypocrisie de l’empereur. La référence à la res publica est nécessaire à la légitimité de l’Empereur. Ce dernier détient un « mandat » du peuple. De fait, l’Empereur « appartient » à la res publica et non l’inverse ainsi que le fait dire l’auteur de l’Histoire Auguste à propos d’Hadrien : « sa mission était de gouverner en sachant que la res publica était la chose du peuple et non la sienne propre »[99].
Retour vers notre futur ?
Le livre de Claudia Moatti nous montre donc l’évolution de la représentation de la res publica au travers de l’évolution qui mène de la République à l’Empire. Mais, elle montre aussi que cette évolution n’est pas le produit de la seule force des idées, mais bien celle de conflits économiques, politiques et sociaux, conflits alimentés par la dégradation des structures agraires et la concentration des richesses qui sont une des conséquences de la 2ème guerre punique. Ce faisant, elle dresse aussi un tableau de la transformation de l’idée de souveraineté et de ses conséquences, en particulier sur le contrôle des magistrats. Cette forme d’histoire intellectuelle, solidement enracinée dans les conflits de toutes sortes qui agitent la Cité est précieuse. Elle conduit, selon les mots même de Claudia Moatti, à re-politiser l’histoire romaine en prenant justement le risque de l’anachronisme[100].
La victoire de la conception cicéronienne de la res publica, il faut le noter, est antérieure à l’établissement de l’Empire. Conçue dans les troubles de la fin de la République, présentée comme une défense de celle-ci, et en particulier dans les œuvres de Cicéron qui nous sont parvenues comme De re publica, De officis et surtout les Philippiques, elle participe de sa destruction. Par le double mouvement de fétichisation de la res publica, et de sa sacralisation, et de réification du peuple, réduit à une entité imaginaire coupée de sa réalité sociale, il entérine le processus de dépossession de la souveraineté. La res publica devenue la chose du Sénat, il n’y a plus qu’un pas pour qu’elle devienne la chose de l’Empereur.
Mais, ces derniers, du moins jusqu’au IIIème siècle, ne franchiront pas le pas. Le principe du peuple souverain sera maintenu, du moins dans l’ordre du discours[101]. Il faudra le basculement de l’Empire vers la chrétienté pour que cette référence disparaisse peu à peu et que se substitue à la souveraineté du peuple l’idée d’un pacte entre Dieu et l’Empereur. Mais, ceci est une autre histoire…
Claudia Moatti en tire les conclusions dans ce passage qu’il convient de citer : « Ceux qui aujourd’hui définissent la res publica comme le gouvernement en vue du bien commun ne s’encombrent pas de ces distinctions, pas plus que les sénateurs de l’époque impériale ; or, l’idéologie est bien différente là encore selon que ce commun dépend des citoyens ou de la cité ; selon qu’il est une notion surplombante ou en mouvement. En mouvement, le bien commun peut-être défini comme le résultat visible de l’action conjuguée de tous (…), surplombant il devient un principe invariable, un universel caché au nom duquel on rejette une partie de citoyens hors de la cité »[102]. Ce passage résonne, dans la France d’aujourd’hui, avec une force certaine.
Notes
[1] Moatti C., Res publica – Histoire romaine de la chose publique, Paris, Fayard, coll. Ouvertures, 2018.
[2] Moatti C., « Conservare rem publicam. Guerre et droit dans le Songe de Scipion » in Les Études philosophiques, 2011/4 (n° 99), pp. 471-488.
[3] Moatti C., « Experts, mémoire et pouvoir à Rome, à la fin de la République », in Revue historique, 2003/2 (n° 626), pp. 305-325.
[4] Moatti C. et Riot-Sarcey M., (edits), Pourquoi se référer au passé, Paris, Editions de l’Atelier, 2018.
[5] Moatti C., Res Publica, op. cit., p. 8.
[6] Voir https://revolution-francaise.net/2014/10/06/585-l-antiquite-modele-dans-le-moment-republicain-de-1791
[7] Millar, Fergus. The Roman Republic in political thought. Brandeis, Hanover, 201 pages, 2002.
[8] Moatti C., Res Publica, op.cit., p.8
[9] Nicolet C., Les Gracques, Paris, Fayard, coll. Follio, 1967
[10] Hinard F. (ed), Histoire romaine T1, Des origines à Auguste, Fayard Paris, 2000,
[11] Voir la critique du livre de Thomas Snégaroff, publiée le 2 janvier 2018 : https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-les-etats-unis-au-miroir-de-star-wars-recension/
[12] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 26.
[13] Cicéron De la République [De re publica], T-1, Trad. Esther Breguet, Paris, Les Belles Lettres, 1980, I.26.41.
[14] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 27.
[15] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 34.
[16] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 35.
[17] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 45.
[18] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 43.
[19] Pani M., La politica in Roma antica – Cultura et praxi, Rome, Feltrinelli, 1997.
[20] Cicéron, Des Devoirs [De Officiis], Livre-1, Trad. M. Testard, Paris, Les Belles Lettres, Universités de France, 1965, I.12.85.
[21] Ce que je soulignais dans Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon, 2016.
[22] Et l’on avoue ici plus qu’une influence de Lukacs G., Histoire et conscience de classe. Essais de dialectique marxiste. Paris, Les Éditions de Minuit, 1960, 383 pages. Collection « Arguments »
[23] Cette question est largement traitée dans le livre écrit pour le Haut Collège d’Economie de Moscou, Sapir J., K Ekonomitcheskoj teorii neodnorodnyh sistem – opyt issledovanija decentralizovannoj ekonomiki (Théorie économique des systèmes hétérogènes – Essai sur l’étude des économies décentralisées) – traduction de E.V. Vinogradova et A.A. Katchanov, Presses du Haut Collège d’Économie, Moscou, 2001. Une partie de l’argumentation est reprise sous une forme différente dans Sapir J., Les trous noirs de la science économique – Essai sur l’impossibilité de penser le temps et l’argent, Albin Michel, Paris, 2000.
[24] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 191-197.
[25] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 17.
[26] Cerami P., Potere e ordinamente nella esprerienze constitutionale romana, Turin, Giappicheli, 1996, 3ème ed.
[27] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 38.
[28] Richard J-C, Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebeien, Rome, BEFAR, 1978, vol. 232.
[29] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 58.
[30] Fiori R., Homo sacer. Dinamico politico-constituzionale di une sanzione giuridico-religiosa, Naples, Jovene Editore, 1996.
[31] Sur le statut de ces terres, Varron (Marcus Terentius Varo), De re rustica, traduction par J. Heurgon et Ch. Guiraud, Paris, Les Belles Lettres, 1978-1997, LL 5.33.
[32] La tradition reconnaissait aux citoyens, à côté de la propriété privée, un droit d’usage sur les « terres publiques », mais ce droit, mal réglementé, fut l’objet de pressions incessantes de la part des plus riches. Rathbone D., « Control and exploitation of the ager publicus » in Aubert J.J. (ed), Tâches publiques et entreprises privées dans le monde romain, Genève, Droz, 2003, p. 135-178.
[33] Loreti-Lambruni, B., « Il potere legislativo del senato romano », in Studi Bonfante, 1930, p. 378-395.
[34] Hinard F. (ed), Histoire romaine T1, Des origines à Auguste, Fayard Paris, 2000, et bien sur l’incontournable Nicolet C., Les Gracques, Paris, Fayard, coll. Follio, 1967.
[35] Mouritson H., Italian unification : a study in ancient and modern historiography, Londres, Bulletin of the Institute of Classical Studies, Supplement n°70, 1998.
[36] F. Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’Empire Romain, Didier, Paris, 1869. Texte tiré de la 7ème leçon, de 1828.
[37]. F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rééd. du texte de 1828 avec une présentation de P. Rosanvallon, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1985, p. 182.
[38] Commons J.R., Institutional economics, its place in Political Economy (1926), New Brunswick, Transaction Publishers, 1990.
[39] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 63.
[40] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 74.
[41] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 82.
[42] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 72-73.
[43] Wiseman T.P., « The Two-Headed State. How Romans explained civil wars » in Breed B.W., Damon C. et Rossi A. (ed), Citizens of Discord : Rome and its civil wars, Oxford-New York, Oxford University Press, 2010, p. 25-44
[44] de Martino, F., Storia della Constituzione romana, Naples, EDI, T1 et T2, 1972 et 1973, voir T2
[45] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 165.
[46] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 196-197.
[47] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 199.
[48] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 222-223.
[49] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 237.
[50] Cicéron, Des Devoirs [De Officiis], Livre-1, Trad. M. Testard, 1.12.85.
[51] J’ai traité de cette question dans Sapir J., Les économistes contre la démocratie – Les économistes et la politique économique entre pouvoir, mondialisation et démocratie, Albin Michel, Paris, 2002.
[52] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 238.
[53] Bretone M., Technice i ideologie des giuristi romani, Naples, EDI, 1975.
[54] Bretone M., Technice i ideologie des giuristi romani, op.cit., p. 17.
[55] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 81.
[56] Astin A.E., Scipio Aemilianus, Oxford, Oxford University Press, 1967.
[57] Wiseman T.P., « The Two-Headed State. How Romans explained civil wars » op.cit..
[58] Fiori R., Homo Sacer. Dinamica politico-constituzionale di une sanzione giudiciaro-religioso, Naples, op.cit.
[59] Mantovani D., Il problema d’origine della accusa populare. Della « questio » unilaterale alla « questio » bilaterale, Padoue, CEDAM, 1989.
[60] Magdelain A., Essai sur l’origine de la sponsio, Paris, TEPAC, 1943.
[61] Nicolet C. « Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion » in ANRW (AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT) Vol. II, n°2, p. 193-214
[62] Licandro O., In magistratus damnari. Ricerche sulla responsabilita del magistrati romani durante l’exercizio delle funzioni, Turin, Giapichelli, 1999.
[63] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 85-89.
[64] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 92-94.
[65] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 126-128.
[66] Labruna L., « La violence, instrument de la dictature à la fin de la république » in Dialogues d’histoire ancienne, Vol. 17, n°1, 1991, p. 119-137 ; Idem, « Adversus plebem dictator » in Hinard F. (ed) Dictatures. Actes de la table ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, Paris, Editions de Boccard, 1978.
[67] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 134.
[68] Hinard F., Les proscriptions dans la Rome républicaine, Rome, Editions de l’Ecole Française de Rome, 1985.
[69] Voir Nicolet C. « Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion », op.cit.
[70] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 138.
[71] Giovannini A., Les institutions de la république romaine des origines à la mort d’Auguste, Bâle, Schwabe ag, 2015, p. 53-55. Golden S.K., Crisis Management during the Roman republic. The role of political institutions in emergencies, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
[72] Dans le cas de Sylla, ce fut la lex Valeria prise à la fin de l’année -82 avant notre ère.
[73] Hinard F. « De la dictature à la Tyrannie » in Hinard F. (ed), Dictatures. Actes de la table ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984, op.cit., p. 87-95.
[74] Lanfranchi T., Les tribuns de la plèbe et la formation de la république romaine, Rome, Ecole Française de Rome, 2015
[75] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 150.
[76] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 154.
[77] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 155.
[78] Loreti-Lambruni, B., « Il potere legislativo del senato romano », in Studi Bonfante, 1930, p. 378-395
[79] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 252.
[80] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 172.
[81] Voir Roddaz J-M, « Imperium : nature et compétences à la fin de la République et au début de l’Empire », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 3, 1992, p. 189-211.
[82] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 253.
[83] Giovannini A., Les institutions de la république romaine des origines à la mort d’Auguste, op. cit.. Ferrary J-L., « A propos des pouvoirs d’Auguste » in Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 12, 2001, p. 101-154.
[84] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 254.
[85] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 255.
[86] Millar F., « Triumvirate and Principate » in Journal of Roman Studies, Vol. 63, 1973, p. 50-67.
[87] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 259.
[88] Cicéron, Philippiques, traduction de A. Boulanger et P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1963 et 1964.
[89] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 282.
[90] Voir Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, op. cit.
[91] Voir Bretone M., Histoire du droit romain, Paris, Editions Delga, 2016, p. 215.
[92] Frezza P., Corso di storia del diritto romano, Rome, Laterza, 1955, p. 440.
[93] Brunt P.A., « Lex de imperio Vespasiani » in The Journal of Roman Studies, vol. 67, 1977, p. 95-116.
[94] Bretone M., Histoire du droit romain, op.cit., p.216.
[95] Sur ces concepts, voir Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon, 2016.
[96] Schmitt C., Théologie politique, traduction française de J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988 ; édition originelle en allemand 1922, pp. 8-10.
[97] Moatti C., Res Publica, op.cit., p. 287.
[98] Veyne P., Le Pain et le Cirque, Paris, Le Seuil, 1976, 1995
[99] Voir Histoire Auguste, trad. D’André Chastagnol, Paris, Robert Laffont, 1994, Vie d’hadrien, 8.3. Texte latin : « saepe dixit ita se rem publicam gesturum ut sciret populi rem esse non propriam », www.thelatinlibrary.com/sha.html
[100] Moatti C., Res publica, op. cit., p. 184-185.
[101] Moatti C., Res publica, op. cit., p. 403.
[102] Moatti C., Res publica, op. cit., p. 411.









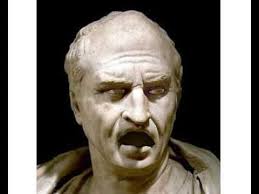

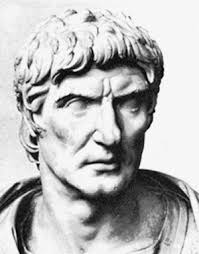











Commentaire recommandé
il serait intéressant, me semble-t-il, que madame moatti dans une prochaine étude, propose une comparaison entre l’histoire romaine et l’histoire grecque. on considére généralement en effet, que les grecs, ou du moins les athéniens, furent les inventeurs de la démocratie. et le romain cicéron, qui avait lu les grecs, aussi biien la République de platon et léoeuvre d’aristote, ainsi que les historiens hérodote et thucydide, se s’est largement inspiré de ces auteurs! et si je partage les regrets de madame moatti concernant léabandon de léenseignement du latin, je regrette tout autant l’abandon de l’enseignement du grec: les auteurs anciens grecs et romains, étaient extrêmement précieux pour comprendre notre propre histoire et pour tout dire, le système des valeurs qui sont à la base même de notre système politique depuis notre première république de 1792, système de valeurs en cours de destruction hélas! et un grand merci à jacques sapir pour cette remarquable recension du livre passionnant de madame moatti.
27 réactions et commentaires
il serait intéressant, me semble-t-il, que madame moatti dans une prochaine étude, propose une comparaison entre l’histoire romaine et l’histoire grecque. on considére généralement en effet, que les grecs, ou du moins les athéniens, furent les inventeurs de la démocratie. et le romain cicéron, qui avait lu les grecs, aussi biien la République de platon et léoeuvre d’aristote, ainsi que les historiens hérodote et thucydide, se s’est largement inspiré de ces auteurs! et si je partage les regrets de madame moatti concernant léabandon de léenseignement du latin, je regrette tout autant l’abandon de l’enseignement du grec: les auteurs anciens grecs et romains, étaient extrêmement précieux pour comprendre notre propre histoire et pour tout dire, le système des valeurs qui sont à la base même de notre système politique depuis notre première république de 1792, système de valeurs en cours de destruction hélas! et un grand merci à jacques sapir pour cette remarquable recension du livre passionnant de madame moatti.
+9
AlerterCe qui fait peut-être la force de l’histoire romaine (en regard de la chose grecque) c’est l’importance du corpus du droit Romain, qui nous est parvenu d’abord de façon lacunaire par le code Théodosien et par le bréviaire d’Alaric et si pendant cinq siècles les sources restent pauvres à partir du 11 ème siècle on retrouve les compilations Justiniennes et il y a une sorte de reviviscence de la totalité de la réflexion tant juridique que politique.
C’est peu de temps après que par un circuit complexe (souvent de traductions en traductions par l’intermédiaire des philosophes et juristes arabes) que les textes antiques grecs de philosophie vont nous parvenir accompagnés de commentaires politiques et juridiques tant arabes, que juifs ou chrétiens latins ou chrétiens d’Orient orthodoxe.
Si Cicéron n’a jamais été totalement « perdu », sa lecture, comme celle de tous les autres, a été médiatisée par de nombreuses strates de pensées (et de langues). Cicéron d’autre part a eu une importance formidable il est à la source du vocabulaire LATIN de la théorie politique comme de la philosophie. Il l’explique d’ailleurs dans le de officiis.Montrant comment souvent il « traduit » mais parfois il « translate » les concepts aristotéliciens,stoïciens ,même épicuriens et surtout platoniciens.
La pensée grecque est à la source, mais Ciceron est un rouage fondamental de la philosophie politique et de son passage à l’effectivité, car il a été un homme politique central de la fin de la République.
Bien sûr la culture classique, qui est celle des plus vieux d’entre nous quand nous « faisions » A ou A’ a disparu des lycées et collèges et c’est une incroyable perte !
Mais ce qu’il faut voir c’est que l’accès « aux textes », au vocabulaire, aux concepts est aussi le produit d’une histoire.
Un livre très intéressant pour suivre cela, cette « exportation », circulation, » translatio studiorum » est le livre de Alain de Libera (prof au collège de France) Histoire de la philosophie médiévale.
Pour l’histoire du Droit et celle du droit romain au Moyen-Age : droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIè-XVè siècles) sous la direction de J; Krynen et A.Rigaudière Bordeaux 1992.
+6
Alerterc’est indéniable que le Latin, c’est utile. En 1950, pour avoir bien travaillé en Latin j’ai eu comme livre de prix les « Contes » de La Fontaine.
+1
Alerter» (souvent de traductions en traductions par l’intermédiaire des philosophes et juristes arabes) »
Il y a bien eu de multiple échange, et la scolastique a bien usée de la pensée Arabe (la plupart du temps n’a été traduit que ce qui a été jugée compatible avec la foi musulmane, et il s’agit essentiellement d’Aristote). Mais cette histoire de vase communicant à sens unique a été largement surestimée et n’est plus aujourd’hui qu’une fadaise (Aristote au mont Saint-Michel de Sylvain Gouguenheim 2008).
Mais plus encore, « la véritable révolution intellectuelle de l’Europe a commencé bien avant la vague des traductions de Tolède et d’ailleurs. C’est ce qu’a montré le juriste américain Harold J. Berman dans son grand livre Droit et Révolution «
« Cette révolution intellectuelle date de la redécouverte (il vaudrait mieux dire « de l’invention ») du droit romain avec la « Révolution papale » au moment de la Querelle des Investitures. On avait besoin, pour mener à bien la systématisation du droit, d’instruments intellectuels plus fins. Il a donc fallu se mettre en quête de celles des œuvres logiques d’Aristote que l’on ne possédait pas et, dans la foulée, du reste de l’héritage grec et arabe. » (Remi Brague).
(H. Berman, Droit et révolution. La formation de la tradition juridique occidentale, tr. R. Audouin, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 2002, XVI-684p.)
Quant a Alain de Libera, au dela de ses compétences, ce dernier a un parti pris politique très dérangeant sur le sujet (Telerama 2008) qui entache sa crédibilité puisqu’il fait de cette question un enjeux politique et idéologique. Il n’hésite pas a citer Le Pen (« Le Pen, le fantasme du chevalier blanc et la fiction mi-littéraire, mi-politique, d’un retour aux “valeurs” de l’Occident chrétien ».) dans un ouvrage d’histoire de la philosophie intitulé « Penser au moyen âge »…
« Notre conviction, dit Libera, est que l’histoire de l’aristotélisme occidental est, pour une large part, celle d’un emprunt – d’un emprunt aux Arabes. On peut encore exprimer cela plus brutalement en disant que le penseur européen des XIIIe et XIVe siècle est un produit d’importation. » « C’est dans le monde musulman que s’est effectuée la première confrontation de l’hellénisme et du monothéisme ou, comme on dit, de la raison et de la foi.»
Saint-Augustin ? les évangiles écrit en grecs ? « En arkhê ên ho logos » ? On jugera sur pièce de la qualité de sa thèse.
+2
AlerterRecension impressionnante, je trouve.
La notion de souveraineté a une place non négligeable dans la construction d’une pensée (théorie ?) économique chez J. Sapir, telle que je la comprend à travers ses publications du moins.
Néanmoins, elle ne me semble pas y tenir une place prépondérante et je m’étonne que J. Sapir en fasse un sujet aussi prépondérant dans ses posts et ses dernières publications.
Sur le texte lui-même, je note le haut niveau de polysémie du mot « république » (même en ne retenant que les sens ayant propriété de cohérence interne) et on peut dire la même chose des mots « démocratie » et « libéralisme », les enjeux de pouvoir se cachant derrière cette guerre du sens.
Du coup et comme Georges ci-dessus je pense, on pourrait s’interroger sur la légitimité à donner une place institutionnalisée à la compétence (technique, juridique, politique, économique…), en rappelant qu’on peut relier compétence à « aristoi » (les meilleurs) donnant « aristocratie » (le pouvoir des meilleurs), qui me semble mieux définir l’équilibre de notre système politique plutôt que « république » ou « démocratie ».
+5
Alerter« mot “république” … mots “démocratie” et “libéralisme”, »
Confusion classique causée par le formatage de nos esprits depuis notre enfance.
UNE RÉPUBLIQUE N’A JAMAIS ÉTÉ UNE DÉMOCRATIE !!!
Une république est une structure pyramidale qui permet simplement de justifier légalement la présence au sommer de l’état de quelques ploutocrates qui possèdent tous les instruments de violence sociale leur permettant de préserver leur pouvoir.
Si le « chef de l’état » est un homme intègre, juste, équitable et respectueux tout se passera bien s’il parvient à « modérer les ardeurs » des autres membres influents de l’état (« élus », hauts fonctionnaires etc…, ça grouille).
Par contre, s’il n’est qu’un petit proxénète violent et cupide accompagné de nombreux « gros bras » (Bonjour monsieur Benalla) vous pouvez être certain que la plèbe va déguster et se fera exploiter au delà du raisonnable.
Le problème, c’est que la première catégorie de personnes ne risque pas de se hisser au sommet de l’état pour deux raisons :
– La première, c’est qu’un tel homme, qui mérite le respect le plus total, ne voudra jamais exercer cette fonction car elle est totalement incompatible avec ses convictions de respect des autres.
– La seconde, c’est tout simplement que si un tel homme avait l’idée saugrenue de briguer cette fonction tous les petits proxénètes se dépêcheraient de le « neutraliser » (au fond d’un lac les pieds dans une baignoire emplie de béton) pour éviter le risque d’une atteinte à leur « business » juteux.
Élections, pièges à c… , république, tu nous n…
+9
AlerterOui les régimes démocrates, républicains et libéraux ne sont pas identiques. Je précise simplement que plus personne ne s’entend sur le sens des ces trois mots.
Je n’ai pas exactement la même lecture que vous sur le « chef de l’état ». Pour moi, s’il y a divergence d’intérêt entre celui-ci et l’élite aristocratique (c’était le cas des rois capétiens avant Louis XIV, de Napoléon 1er ou de Charles de Gaules avec sa personnalisation de la fonction présidentielle,),on peut le décrire comme intègre… sinon on peut le décrire comme petit proxénète si vous voulez. Le problème est qu’il y a une évolution inexorable du premier au deuxième et que de ce point de vue, la 5ième république ne pouvait être qu’un échec à termes.
On peut injurier le concept de république si vous voulez mais d’un autre côté, on peut aussi dire que le devenir tendancielle d’une démocratie radicale est la guerre civile. Les grecs s’en plaignaient.
Ceci dit, je n’ai pas de solution idéale à proposer aussi je ne critiquerais pas votre opinion d’autant que je la partage en partie.
+4
AlerterPeut-être êtes vous trop belliqueux… Ce qui peut-être justifiable, ou justifié en regard de ce que nous subissons mais bellicisme qui est contre-productif.
Vous passez d’un pouvoir pluriel à un pouvoir singulier pour revenir à un pouvoir pluriel.
Hors le pouvoir réel n’est que la sommes des forces singulières qui s’expriment, exclusion faite des forces singulières qui s’ignorent comme étant détentrices d’un pouvoir latent et potentiel.
Ensuite il convient de voir et savoir qui l’exerce, comment et à qu’elle fins. Un représentant ou un consensus ?
Vous parlez donc « d’un chef de l’état », au singulier, ou d’une collusion d’intérêts. Certes, il y a là un piège. La personnification qui permet à tout un chacun de s’identifier au « personnage » et ainsi renoncer à sa force singulière. Et là, un Président vaut bien un Roi qui vaut bien un Empereur puisque tout un chacun fait allégeance en renonçant à ses prérogatives propres pour un dividende.
Ensuite, oui, élection, piège à couillons. Mais quoi alors ? Consensus ? Allons pour consensus!!!
Mais va falloir bosser dur, parce que le peuple a réellement besoin d’informations. Comment dire ? D’instructions ? Oui, le peuple a besoin d’instructions, comme autant de mode d’emploi, qu’il ne lit pas d’ailleurs… Le peuple ne lit plus; il voit, il entend et ingurgite (organe). Attention… Ni il regarde, ni il écoute et digère (fonction).
La plupart des modes d’emploi de la consommation poubelle finissent à la benne avec les emballages avant d’être lu pour y rejoindre tous les objets obsolètiquement programmés et illico presto remplacés par le summum du renouveau moderniste, fournis avec emballage et mode d’emploi qui finissent à la benne avant…. Sisyphe au-secours !!!
Cessons de causer Président, Roi et autres Empereurs… le peuple doit s’instruire, lire les modes d’emploi, s’instruire et s’assumer… ou pas !!!
» L’expression latine primus inter pares, signifiant littéralement « premier parmi les pairs », peut avoir un sens en politique et en psychologie. »
« L’expression primus inter pares désigne une personne qui préside une assemblée sans avoir de pouvoirs propres. On l’emploie pour souligner l’égalité formelle entre les membres ou le fait que les décisions sont prises par consensus, notamment au sein d’un gouvernement. »
La suite ci-dessous:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares
Les mots ont un sens. Le sens donne une direction.
+3
AlerterPfft, rasoir, ce Sapir… Question méthodo, il n’arrive pas à la cheville des géants scientifiques d’EU Disinfo Lab…
Bon, sérieusement : il faut lire cet article de fond. L’histoire de la république romaine nous éclaire encore, comme le montre cette comparaison de M. Sapir : « Dans ce « peuple » mis en tutelle par l’élite sénatoriale, on peut retrouver comme un écho lointain de la volonté de mise en tutelle du peuple actuel par « ceux qui savent », à la condition que ces derniers fassent preuve de « pédagogie ». Le parallèle est d’autant plus tentant que, peu à peu, les décisions du peuple sont contestées voire révoquées, comme ce fut le cas avec le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne qui suivit en 2007 ».
Je me demande si la fameuse formule SPQR (Senatus Populusque Romanus, « le Sénat et le Peuple romain ») ne traduit pas cette volonté du Sénat romain de passer avant le peuple des citoyens. République certes, mais république oligarchique.
+6
AlerterRésumé très intéressant qui nous démontre que chaque fois qu’un système politique est érigé, même s’il l’est sur des bases « équitables », il devient très rapidement au service d’une caste qui profite de ce pouvoir pour accroître sa puissance et ses richesses.
D’ailleurs, dès la rédaction de sa « constitution », TOUT système politique contient dans ses textes fondateurs quelques petits « articles » qui, au fil du temps, permettront grâce à quelques retouches successives et « innocentes » à faire évoluer sa structure vers un système qui deviendra à terme une tyrannie incontournable.
Le ver est à l’origine dans le fruit et il suffit simplement de lui permettre de se développer en catimini.
Par contre, une chose que les romains avaient compris dès le début, c’est qu’un tyran, un « politicien professionnel » ou un « lobbyiste » ne changera jamais ses objectifs une fois passé du « côté obscur de la Force ». Ce qui explique totalement la violence politique sanglante qui sévissait à l’époque, les « opposants » tentant d’assassiner le tyran ou l’homme influent qui leur était néfaste, et ces derniers pratiquant les mêmes stratégies pour sauver leurs peaux à l’encontre de ceux qui souhaitaient les faire disparaître de la vie politique.
Dans « nos » « démocraties exemplaires » les politiciens ont réussi l’exploit de se mettre hors de portée de toute possibilité légale de rétorsion en cas d’abus ou de trahison en s’accordant eux-mêmes une immunité gravée dans le marbre des textes fondateurs de nos institutions.
Pour résumer, nous visons dans une « tyrannie douce » constitutionnelle et il est strictement impossible à la plèbe de pouvoir se défendre contre la dictature institutionnelle.
Et pour assurer leur sécurité les ploutocrates ont mis en place des règlements et des lois bien pyramidaux qui imposent à tous leurs « collaborateurs » une obéissance et une servilité sans failles.
A mon avis, dans le cas d’un nouveau « Nuremberg » tous les « décideurs » et leurs « vassaux » risqueraient fort de se pendre au bout de cordes à l’issue du jugement.
Je tiens à vous rappeler que le fait de se défendre en se réfugiant derrière le respect des lois en vigueur n’a pas été retenu comme circonstances atténuantes. Si une loi ou un ordre donné par la hiérarchie est contraire au respect d’autrui il ne faut pas les respecter.
J’invite d’ailleurs les « forces de l’ordre » qui répriment les manifestants à méditer sur ce dernier point.
On ne sait jamais, ils pourraient un jour avoir à répondre de leurs actes en cas de « changement de direction » politique si d’aventure la plèbe retrouvait ses droits.
Et dans ce cas, je n’aimerais pas être à leur place car la rancœur accumulée depuis des générations risque fort de les transformer en boucs-émissaires exemplaires.
+6
Alerterbonjour, bonsoir,
les payeurs sont les décideurs….
il y a tjrs une dynamique censitaire dans une communauté in-égalitariste : hier, les propriétaires fonciers corrompaient qui de droit pour maintenir et étendre leurs privilèges, aujourd’hui, les financiers se « paient » des amnisties fiscales…
parfois, trop, c’est trop, et c’est la guerre civile !!! Vivement le communisme…
Moi, je préfère la Grèce : égaux sur le champ de batailles = égaux en droits (politiques), c’est plus net/propre. L’architecture du pouvoir Romain, ces combinazione proto-byzantines brouillent les cartes, et font accroire que le peuple avait son mot à dire : sophisme !!! Pourtant, Jacques Sapir n’en démords pas, or il se trompe…
pour ceux qui aiment lire sur le thème : « Histoire économique et sociale de l’Empire Romain » de Rostovtseff, un russe « blanc »…
Geoffrey, neo-communiste belge
+5
AlerterJe me souviens avoir découvert la notion de « souverain » et par là celle « DU peuple souverain », en lisant, ou disons plutôt en essayant de lire « le contrat social » de J.J. Rousseau. Comment dire ? Vous vous levez un matin avec une pèche d’enfer et il vous prend l’envie saugrenue de tenter un marathon de 30 bornes. Hors, vous n’avez jamais couru plus de 3 bornes. Au mieux, vous vous souvenez des vos 100 mètres en sprint que votre prof de collège vous imposait en éducation physique. Vous n’y étiez pas trop mauvais, mais en sortiez épuisé. Il y a ces quelques fois, aussi, où vous avez couru après le bus de ville et où ce sale gosse, à l’arrière, vous tirait la langue sans dire au chauffeur de vous attendre. Grand moment d’effort, de solitude… et de colère envers tous les sales mioches à l’arrière des bus. Il y eut donc aussi cette colère envers les « érudits » si dur à suivre… à l’intérieur des livres, et qui comme les sales gosses à l’arrière des bus vous tirez la langue à l’arrière des livres, en quatrième de couverture…
http://www.breakingscience.be/fr/saga-des-heros/einstein-un-genie-indiscipline-2
30 ans plus tard… 🙁
Qu’est-ce donc un peuple ? LE Peuple ? Populaire ? Popularité ? Populisme ? Population ? Populace ? Mouaich, c’est déjà l’idée d’un vocabulaire riche. C’est à dire que chaque terme renvoi vers un concept propre et/ou figuré et que c’est la multiplication des concepts qui favorise le développement cognitif, la capacité à réfléchir puis transposer des acquis vers des hypothèses. Puis d’hypothèse en hypothèse, aller d’antithèse en antithèse pour finalement thèser…. Et non pas taise, taire, traire ou boire un thé…
L’on comprend peut-être « l’intérêt » de supprimer le latin des écoles de la « république des bananes ». Non pas pour éloigner le quidam, « le populus », d’une étude poussée des textes en VO faisant état des tourments des vieilles souverainetés-républiques-empires-démocratures, mais d’empêcher les têtes « blondes » de développer leur cervelle en ne leur permettant pas de multiplier les connexions synaptiques et augmenter les flux neuronaux de façon efficiente durant leur développement cérébral naturel. (CF. Neurobiologie. Plastique du cerveau. H.Laborit et d’autres…)
En gros, la fabrique des idiots :
» Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que CHACUN devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. »
« sur l’instruction publique » (1791-1792), dans Œuvres, condorcet, éd. firmin-didot, 1847, t. 7, second mémoire (« de l’instruction commune pour les ENFANTS »), p. 212 – sur l’instruction publique, 1791-1792 – Nicolas de Condorcet
Nous savons :
1- Que l’union fait la force et par ce fait nous savons aussi que le tout est supérieur à la somme des parties :
« la tendance dans la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs à la somme de leurs parties, au travers de l’évolution créatrice. » Voir Holisme.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holisme
2- Que la division permet de régner :
Diviser pour régner provient du latin « Divide ut regnes ».
• En politique et en sociologie, diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d’un tout pour les affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie, et permet de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question.
• Chez Machiavel : « Divide et impera », ‘divise et règne’.
• En informatique, diviser pour régner est une méthode de conception d’algorithmes réduisant récursivement un problème en un ou plusieurs sous-problèmes du même type (ou de la même classe de problème).
3- Qu’il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir :
« Une telle jalousie ne va pas sans incompréhension, ni aveuglement ; il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, surtout quand ce qui est à voir ne peut être vu qu’avec les yeux du cœur. »
(Clive Staples Lewis, Un visage pour l’éternité: un mythe réinterprété, 1956)
En ces temps modernes, progressistes, libéraux, libertaires et libertariens, la popularité (popularisme ?) est le nerf de la guerre. Mais l’individu ne se réclame plus du peuple dont il est issu (tissu) en ne revendiquant plus sa popularité propre, singulière avoir pignon sur rue). Il délègue sa popularité personnelle à une popularité élitiste représentative de son imaginaire. Par exemple en se revendiquant supporter de tel ou tel club de foot ou professant tel ou tel évangile. Plus largement de telle ou telle idéologie. Il en ira presque de sa vie, et du sens qu’il confère à celle-ci, que son club, son écurie, sa paroisse soit portée aux nues… édifiante et sacro-sainte réalisation de sa toute puissance fantasmée.
Tous les subterfuges sont employés pour neutraliser l’idée de peuple en créant autant de paroisses que nécessaire pour diluer en sous ensemble l’ensemble populaire, soit le peuple invertébré. Et chacun, plutôt que de se comprendre comme essentiel au tout, essentialise le sous-ensemble du quel il pense être issu et désintégrant de la sorte le tout en conférant son pouvoir à l’élite qui l’a subjugué et à laquelle il s’identifie en la glorifiant.
Ainsi donc, nous sommes les champions du monde, mettant en avant tout ce qui nous divise avec force étendards et slogans fédérateur. Alors quoi, les romains ont quelque chose à nous apprendre, en grec ou en latin ? Moi j’y perd mon français…
Panem et circenses et… populare !
http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/POPULARE/index.htm
+4
AlerterA_
« Pourquoi donc le détour par l’antique s’impose-t-il de manière aussi insistante? »
Avoir comme domaine de recherche l’« Histoire intellectuelle » et ne pas souligner que la résurgence de l’antique est étroitement lié a la renaissance en contre-poids de la période précédente fortement religieuse et dis-qualifiée a ce titre de moyenâgeuse, est comique. Ou comment alimenter ce qu’on dénonce.
B_
« Cette forme d’histoire intellectuelle, solidement enracinée dans les conflits de toutes sortes qui agitent la Cité est précieuse. »
Conflit conflit conflit : encore cette lecture marxiste de l’histoire qui ne perçois l’homme et son rapport a l’autre que dans la lutte de pouvoir.
C_
« Elle conduit, selon les mots même de Claudia Moatti, à re-politiser l’histoire romaine en prenant justement le risque de l’anachronisme »
Ahh l’anachronisme, le péché des péchés de l’historien. Qu’un historien prennent ce risque – même justement – interroge sur son ambition. « Je sais bien que l’anachronisme est inévitable, mais quand même, je dois l’éviter à tout prix » Lucien Levebre.
Politique avez-vous dis ?
Quand on publie sur « Les paradoxes de l’immigration dans l’Empire romain » en intitulant un des chapitres « La protection des migrants » (terme de novlangue ultra-contemporain = google trend) les choses s’éclairent. Elles s’illuminent même un peu plus à la lecture des tribunes qu’elle publie dans LIBERATION en regrettant que les programmes d’histoire n’en font pas assez dans la reconnaissance de l’altérité. « il faudrait un récit commun problématique qui apaise «les passions françaises». Voila a quoi sert l’histoire pour madame.
Pourquoi chercher a tout prix l’antique pour analyser la république ? Cette fragile idée a été construite laborieusement en interaction continue avec l’histoire qui l’a précédée et dont la 5e (la plus stable connue) à été fondée par un monarchiste convaincu qui a érigé le chef de l’état en « monarque républicain » (Michel Debré). L’ignorer a ce niveau procède d’une hémiplégie volontaire.
La notion de « bien commun » n’appartient pas à la rome antique. Plutôt que de politiser et d’instrumentaliser une histoire vieille de 2000 ans pour justifier un combat politicien, j’irais chercher celle qui a irriguée et forgée 1500 ans de notre histoire directe et qui continue de le faire même sous la republique.
Comme si la religion n’avais pas cours dans l’empire romain et la dévotion n’étais pas le ciment de la société romaine (familial, étatique et religieuse) avec la fameuse Pietas. Évidemment cela ne plaira pas a ceux qui pensent l’opium du peuple, mais cela évitera une hémiplégie épileptique.
+2
AlerterSur le conflit, j’ai pareillement tiqué, mais pour des raisons différentes. Sapir fait du conflit le moteur du progrès, là où je ne vois qu’un gâchis d’énergie. Marx ne faisait que constater le conflit, et propose son dépassement (l’égalité des classes).
Pour le reste, je suis d’accord avec vous. Comme quoi, tout peut encore arriver…
+1
AlerterSur la question du conflit, il y aurais matière à débattre. Formulé ainsi je comprend le malaise. Mais ce n’est pas tant le conflit que l’épreuve dont il faut peut-être penser la force créatrice (une subtilité qui échappe aux humanistes). Ce qui pose la question de la violence.
Justement, le soucis avec le point de vue marxiste, c’est qu’il déforme tout sous la loupe grossissante de l’oppression (dominant-dominés, en privilégiant évidement ces derniers) et de l’exploitation économique. La finalité appel a la révolution pour façonner l’homme nouveau, (qu’il faut bien justifier). Cette science totalisante au sens Hégélien du terme a pour vocation de tout expliquer en système fermé. C’est la vision matérialiste de l’histoire. « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de luttes de classes », grille que l’on retrouve chez Jaurès (l’Histoire socialiste ) qui se banalise et mute ensuite pour atteindre son apogée dans les années 60-70 jusqu’a irradier l’ensemble des sciences-sociale.
Oui, pomelos existe, mais c’est un peu trop obsessionnel pour moi. Cela n’enlève rien aux puissants constats qu’il a pu faire ni les apports positifs que cela a pu avoir sur la question des interactions (même Duby reconnais sa dette mais sait aussi s’en détacher).
Le hic, c’est le rapport de Marx avec la violence, qu’il vois partout et qu’il juge nécessaire (la fameuse sage femme, la force créatrice). De plus, il dépasse de loin le constat, il veut engendrer une philosophie de la praxis qui se détacherais de la philosophie de la contemplation, « la réaliser » en l’ancrant dans l’anthropologie. Volonté que l’on retrouve chez Feuerbach (« c’est l’homme qui fait la religion »), qui l’influencera fortement. La critique de la religion est la pierre angulaire de cette nouvelle philosophie, et lui fait bien évidement concurrence (« La critique de la religion est la condition de toute critique ») pour soi-disant rendre à l’homme à lui même.
Au delà de ça, vous m’avez donné une leçon et je vous en remercie.
+1
AlerterNietzsche, dans naissance de la tragédie, va aussi chercher dans l’antiquité pour comprendre le présent, mais du coté de la Grèce. Pour lui, c’est la disparition du choeur dans la représentation du réel qui marque la fin de la société. Le choeur, représentation du peuple comme puissance naturelle, dionysiaque, à opposer au rationalisme apollinien, pur et désincarné.
A Rome, les religions n’étaient plus le ciment de la société romaine depuis longtemps, ce qui explique notamment le succès du christianisme.
Marx propose aussi un modèle de transcendance : façonner l’homme nouveau, le monde sans classe. C’est une religion matérialiste, apollinienne, désincarnée. Il le fait dans un contexte de délitement de la chose religieuse, le 19ème siècle où « triomphe » de nouveau la raison. Il dénonce les marchands du temple mais jette le bébé avec l’eau du bain en oubliant le choeur, pourtant crucial pour sa révolution.
Au mieux c’est un passe temps dominical créateur de liens sociaux, de braves gens abusés par des clercs vicieux, … Un peu comme le foot ou la politique. Désincarné.
Cela dit, ce n’est pas au chapitre des religions que je consulte Marx, mais bien celui de son analyse bien rationnelle du capitalisme, de la lutte des classes, de la répartition des richesses, et des moyens de cette richesse : la propriété.
Rome ne s’est pas effondré à cause de sa royauté, dictature, tyrannie, république, ou dieu sait quels régimes elle a connu durant ses mille ans. Elle s’est effondrée à cause de l’avidité de ses grands propriétaires qui malgré la fin de l’expansion impériale (et du pillage associé), continuent de s’empiffrer au-delà de toutes mesures, comme les grandes maisons des Chacos : https://www.les-crises.fr/canyon-chaco-terre-chaco-par-chris-hedges/
« Le passage de la petite propriété foncière aux grandes exploitations dont la main-d’œuvre est essentiellement composée d’esclaves, mais aussi l’accaparement des terres publiques par l’aristocratie, créent une situation intenable ».
+0
AlerterOn va laisser Nietchze ou il est, il n’y a pas de preuve qu’il ai lu Marx, il ne ferais qu’embrouiller l’ensemble. De plus Marx aimais aussi les grecs avec son prométhée, en digne disciple d’Hegel.
Sinon, beaucoup d’erreurs qui nous ferais digresser trop loin. Les imprécisions de votre vocabulaire vous fait confondre science et raison, Pietas et religion, et oublier quelques notions d’histoire en passant, comme Constantin.
Mais je vous remercie de me fournir un exemple patent de ce que je critiquais plus haut : vous produisez une grille de lecture fermé sur elle même, et donc à causalité unique. Ce qui vous fait dire : « Rome est tombé a cause de ça ! ». En gros « Parce que les opprimés étaient victimes des oppresseurs » : ce que Marx a sacralisé : le rapport de domination. C’est joli, mais vos preuves sont maigres, votre lien sur la culture Anasazis est plutôt douteux (ils ont laissé « assez peu » de traces écrite), et les théories sur la ou les causes de la chute de Rome sont nombreuses (certains pensent même qu’elle a simplement mutée) et surtout, « multifactorielle ».
Et pour soutenir votre hypothèse, vous me citez un passage qui traite d’une époque bien antérieure de plusieurs centaines d’années. (IIème Guerre Punique : 218-202 av. J.-C.).
Franchement ?
+0
AlerterJ’appellerais désaccord ce que vous appelez erreurs, oublis et imprécisions, car je pourrais vous rhabiller de la même façon tant j’ai du mal à comprendre votre rejet du matérialisme historique qui moi me saute aux yeux. Vous n’êtes pas d’accord avec moi, c’est quand même mieux que vous êtes dans l’erreur et donc moi dans le vrai, et vis versa.
Y eut il d’autres raisons à l’effondrement que la crétinerie des propriétaires et leur juridisme pompeux ? Oui, certainement. J’aimais bien l’idée de Nietzsche justement : une mutation dans les représentations du réel. Ca nous change des platitudes juridiques latinisantes qu’on nous ressort depuis le 12ème siècle.
Rome ne s’est pas effondrée en un jour, et c’est bien entre les deux guerres puniques que l’extension va commencer, avec et après la « réunification italienne », soutenant dans son sillage l’accaparement des terres publiques par l’aristocratie.
+0
AlerterLa j’entend mieux.
Je ne rejette pas les apports du matérialisme historique (voir mes propos plus haut), j’en rejette les excès et ses angles morts . Ce qui vous saute au yeux, c’est ce que votre grille de lecture vous montre. Est-elle complète pour autant ? Vous me semblez trouver que ce que vous voulez chercher. Quand on est exclusivement centré sur l’économique, on trouve de l’économique. Que je sache, les romains n’étais pas athée et la séparation du droit et de la religion reste une question débattue. La structure tripartites – Dumezil – (production, guerrier, sacré) se retrouve bien dans la société romaine alors que le matérialisme historique se concentre sur la production. Enfin c’est a Ciceron que nous devons aussi le terme de la Culture : habiter, cultiver ET rendre un culte. Le matérialisme, dans son anthropologie, considère la cité comme le résultat d’un pacte, d’un contrat entre individu, a la suite de Hobbes. Mais cette idée est une invention récente.
Sans vouloir être désagréable, je maintiens les imprécisions et les erreurs : Je disais que la dévotion étais un ciment, pas la religion. La dévotion marque l’obligation qui n’est pas de ce monde (Weil). Quant à la religion, c’est un facteur determinant que le matérialisme historique s’évertue a passer a la trappe car c’est son angle mort.
Vous me parlez de la raison qui triomphe a nouveau face a la chose religieuse, et ce faisant vous méconnaissez gravement la place de la raison dans la religion chrétienne (vaste débat mais en vrac, on l’a vu le droit romain, la renaissance carolingienne, le pape Sylvestre II, les inventeur du big bang et de l’adn… en résumé : « je sais qu’on accuse l’Église d’abaisser la raison, mais c’est juste le contraire. L’Église est la seule sur terre à reconnaître que la raison est suprême. L’Église est seule sur terre à affirmer que Dieu lui-même est tenu par la raison « Chesterton ).
Au 19e, il y a bien eu un conflit entre science est foi et c’est bien l’aspect religieux qui est attaqué (on l’a vu plus haut) en instrumentalisant parfois la science (Darwin) dans un combat politique ( le Kulturkampf allemand , republique contre royalisme en France, Italie…).
Quant au délitement de la chose religieuse, (le délitement suppose une désagrégation d’origine naturelle et inexorable) s’il est en effet question d’un certain embourgeoisement des membres du clergé et une adaptations au découvertes scientifique, c’est oublier Rerum Novarum, le catholicisme et le christianisme (protestant) social a qui l’on doit les prémices de la sécurité sociale, l’armée du salut, c’est oublier encore le renouveau spiritualiste de la fin du 19e, le Great Awakening protestant, « le réveil » en France, le Second Great Awakening, le pentecôtisme, etc etc. Votre propos est surtout une image véhiculé par l’élite convaincu par l’humanisme athée, la piété populaire restant vivace (voir la ferveur du pelrinage de Lourde au 19e). La fausse opposition entre raison et religion n’est qu’un fruit vérolé de ce conflit.
Je ne suis pas convaincu par votre cause de la chute, même s’il est fortement possible que ce soit un facteur non négligeable. Je n’ai pas d’avis tranché et les historiens sérieux continuent de s’échanger des arguments (budgétaire ou financier, invasion, christianisme, affadissement moral, continuité carolingienne, pression Sassanides, perte de territoire, sécheresses, corruption, etc). 500 à 600 ans en avance, c’est un peu trop en amont a mon gout. A ce titre, la naissance d’une civilisation contient en elle les germes de sa destruction, inutile de réveiller Marx pour cela. La chute de Rome fait fantasmer, et les réponses, comme avec ce livre, sont souvent en échos avec les inquiétudes du temps. La réalité c’est le manque de données.
Quand a la mutation du regard sur le réel, la je vous suis complètement. Mais je n’irais pas chez Nietzsche pour cela. Elle c’est fait à mon sens bien plus tôt avec l’avènement de l’humanisme du coté de la renaissance justement. Vous trouverez deux variantes sur ce sujet : Remi Brague (les mutations de l’humanisme) et Alain Descolas (les 4 ontologies). Il y en a d’autres.
Merci pour vos réponses. Charité oblige, je ne demande qu’a être rhabillé, je suis certains de me tromper quelque part.
+0
AlerterGuerrier, sacré, production.
Tribun, tribune, tribu.Verticalité du pouvoir. Depuis le néolithique dit on.
Je remplacerais sacré par clercs. Jusqu’au 18ème, les clercs spirituels justifiaient le pouvoir par dieu. Durant le 19ème et jusqu’à la séparation de l’église et de l’Etat, ils sont remplacés par des clercs matérialistes : des « économistes », et le pouvoir est justifié par « la science ».
C’est en cela que je parlais d’un « triomphe de la raison » et d’un délitement de la chose religieuse, étant entendu que cette « science » économique n’est qu’une religion matérialiste, désincarnée, et qu’il n’y a rien de moins raisonnable que la raison pure, désincarnée : la forme sans le fond, le sophisme…
Economie, c’est l’administration de la maison, de la cité. Soit un synonyme de politique, malgré ce que tentent de nous faire croire les néolibéraux. Pour comprendre une société, c’est un facteur déterminant.
Si je suis dans l’erreur, n’hésitez pas à le démontrer. Sinon il ne s’agira que d’un désaccord.
+1
Alerter« les clercs spirituels justifiaient le pouvoir par dieu »
« nulla potestas nisi a Deo » Saint Paul.
Sans méconnaitre l’importance de l’oikos et du nomos (vous noterez la polysémie des termes), tout n’est justement pas qu’une question de pouvoir. C’est encore – et toujours – cette grille dominant/dominé. Et surtout, c’est nier la distinction du temporel et du spirituel en flirtant avec la notion de théocratie, on ne peut plus fausse ici. De quel pouvoir parlons nous ici ? de quelle sécularisation ? C’est, pour revenir a l’article qui nous concerne ici, faire la distinction entre l’auctoritas (notion fondamentale « bizarrement » peu évoquée qui revenais au Sénat) et la potestas comme le faisais l’eglise en reprenant le juriste Ulpien.
De plus, caser le terme matérialiste derrière un peu n’importe quoi : religion, clerc, et pourquoi pas la transcendance matérialiste (on y étais presque) ou métaphysique matérialiste (oxymores en vue) entretient un flou malgré les réalités pleine ou partielle que cela peut recouvrir. Ce flou et la légèreté qui les accompagne – malgres vous ? (j’entend le manque de place pour dérouler une thèse ici)- vous place du côté des relativistes, pour qui une religion – matérialiste – en vaudrais bien une autre, tout comme une transcendance en remplace une autre, avec un large usage de termes interchangeables. Je trouve vos comparaisons malvenues. Il n’y a rien de plus faux la aussi que de parler de transcendance pour le surhomme humaniste puisque l’homme n’a plus que lui même pour horizon. Il n’est pour autant pas faux de noter que le vide laissé dans la société cherche désespérément a se remplir par quelques succédanés que ce soit.
Cela ne m’empêche pas de vous rejoindre sur l’irrationalité qu’il y a de croire en la raison. Alors, simple désaccord ou erreur fondamentale dans la grille de lecture ? Je note une difficulté à s’entendre sur les termes.
+0
AlerterThéocratie : royauté de droit divin ou main invisible du marché, dans les deux cas je vois des clercs ou des orateurs justifier un pouvoir bien temporel à grand renfort de formules savantes. Je ne crois pas que dieu ait placé là les rois de France, tout comme je ne crois pas au scientisme moderne. De quel pouvoir spirituel parlez vous ?
Vous parliez de dévotion, phénomène étrange s’il en est. Comment distinguer le crédule du croyant ? La foi sincère oui, mais en quoi croire ?
Le catalogue est immense, il paraît même que parmi les robots ils auraient retrouvé de vrais gens qui croient en notre président.
Pour autant je ne me considère pas relativiste. Chez les chrétiens, dont je suis culturellement au moins, il y a cette parabole du samaritain : mieux vaut un vagabond dépenaillé qui n’est pas d’ici (un migrant ?) qui agit que deux clercs bien de chez nous qui détournent le regard.
On pourrait presque dire mieux vaut un bon musulman qu’un mauvais chrétien, et vis versa. Relativiste Jésus ? Non, il distingue la sincérité du baratin et fait de cette sincérité une condition primordiale du salut : le chemin, la vérité, la vie.
J’apprécie votre culture, et la possibilité que vous laissez au dialogue malgré nos divergences. Le dialogue, aussi difficile soit il, permet de résoudre le conflit. C’est peut être « l’épreuve » dont vous parliez : une épreuve de clarté et de sincérité.
+0
AlerterJean 18:36 Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Le catholicisme n’a jamais été et ne sera jamais une théocratie au sens strict du terme. Impossible (Marcel Pacaut – pouvoir détenu par une classe cléricale). L’histoire des tribulations entre pouvoir temporel & spirituel avec la théorie des deux glaives est la pour en témoigner. L’egypte des pharaons en est une. Apres, si on relativise les termes…
La dévotion implique un dévouement (famille, état…), dans le contexte romain : pas nécessairement une croyance au sens religieux, mais une dimension sacrificielle, de dévouement et de soumission (racine devotio de devorere) qui échappe justement complètement aux analyses de l’article. L’auctoritas étais la continuité de la Tradition. Une Tradition qui a été escamoté de notre monde contemporain. Quand a l’autorité…
Vos questions nous entraine trop loin, nous risquons un hors sujet, mais je vous invite a les creuser. La parabole du bon samaritain – a tiroirs – est intéressante mais il y en à d’autres. Prenez comme appui que la religion et la superstition sont deux choses que tout oppose tout comme il ne faut pas confondre Foi, Croyance et Confiance. Ces 3 éléments sont a la base de beaucoup de chose. Une analyse juridico-économique d’un athée sur le monde romain passe a coté d’un éléments important. Comme je le suggérais plus haut avec Hobbes, il y a une question anthropologique importante qui n’est pas abordé ici : comme un éléphant au milieu du salon. Seul l’usage de la raison et du coeur intelligent (Salomon – Arendt) peuvent éclairer votre chemin. Quant a votre sincérité, même si « heureux les pauvres en esprit… » j’ajouterais que « l’enfer est pavé de bonne intentions ».
« Le monde moderne n’est pas méchant ; à certains égards il est beaucoup trop bon. Il est rempli de vertus farouches et gaspillées. Quand un certain ordre religieux est ébranlé – comme le Christianisme le fut sous la Réforme – les vices ne sont pas seuls à se trouver libérés. Certes les vices sont libérés et ils errent à l’aventure et ils exercent des ravages. Mais les vertus aussi sont libérées et elles errent, plus farouches encore, et elles font des ravages encore plus terribles. Le monde moderne est envahi des vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles pour avoir été isolées les unes des autres, contraintes à errer chacune en sa solitude. Nous voyons des savants épris de vérité, mais leur vérité est impitoyable ; des humanitaires uniquement soucieux de pitié, mais leur pitié – je regrette de le dire – est souvent mensongère… »
©GK Chesterton.
Il ne s’agit de ne pas tomber ni dans l’irénisme, ni dans le bellicisme. Seul la vérité rend libre, et cela ne se monnaye pas. Puisqu’on parle d’histoire, déjà posté ici mais :
Comme le souligne H. Arendt : l’exercice de la polis chez les Grecs consistais en un discours incessant qui révélais le nombre infini de situation et un flot inépuisable d’arguments (les Sophistes). « Il m’apparait » en Grec prend racine dans « opinion ». Cela leur permis d’échanger les points de vue, ils apprenaient – non pas à se comprendre- mais à comprendre le même monde à partir de la perspective d’un autre. Ce haut degré d’objectivité se retrouve chez Thucydide qui fait s’énoncer les positions et les intérêts des parties en guerre, ou Hérodote qui écrit pour sauvegarder la gloire des actions des Grecs ET des Barbares. (Je me contente de reformuler).
Quoi de plus important que nos racines pour comprendre ou l’on va, n’est ce pas le but de cet article ?
+0
AlerterEtant dans le sujet et vos réflexions, j’en oubliais de vous remercier pour vos compliments que je vous retourne avec plaisir. Je pourrais me retrouver dans vos propos, pourtant je suis en total contradiction avec vos formulations. Cela donne une sorte de disputatio médiévale (disputare) que l’on retrouve déja chez Ciceron et Quintilien, hérité de la dialectique Grec.
Une réflexion pour revenir sur les 2 sujets qui nous occupe : l’article et la lecture du monde antique, il faut comprendre que nous avons vécus une inversion, de sens, de valeurs, de concept.
Toujours a propos des terres, a Rome, quand on voulais complimenter un homme on disais de lui qu’il étais un bon cultivateur : Caton L’Ancien (même époque) a propos des grands hommes politique ou des hommes de bien. L’agriculture était sacrée et le siège de la Culture. Ce à quoi aspirais les centurions apres une vie de guerre, comme récompense. Le cultivateur arrivais dans la cité avec un avantage : il pourvoyais a sa survie. Chez les Grecs, c’etais un travail avilissant bon pour un esclave. Aujourd’hui c’est un métier plus méprisé à certains égard que celui de journaliste (c’est dire), avec un des plus fort taux de suicides. Est ce que cela va dans votre sens, ou le mien ? je ne tranche pas, vous allez voir plus bas.
L’individu n’existais que s’il se faisait un nom. Dans le monde ancien, l’individu étais en bout de chaine, et faisait d’abord partie d’une communauté, corporation, etc. Ce n’est qu’a partir de la qu’il se construisais une individualité. Dans notre modernité, l’individu est la base et le préalable de tout. L’individu, son unicité, l’incommensurabilité de chacun nous renvois a ce qui est mesurable : les quantités. Contre les qualités. Dans l’ancien monde : on tient sa place, celui ne tient pas sa place chute chez les grec : l’hubris. Malgres un heritage grec dans l’esclave qui murmure « Memento mori » (« Rappelle-toi que tu es mortel ») ( ou une autre formule) à l’oreille du général victorieux lors de la parade sur son char, la notion est évacuée petit a petit du monde romain. Les empereurs, en se divinisant et en instrumentalisant la religion déstabilise la juste mesure (pan metron), Avec pour résultat de découpler le romain de la religion d’Etat. Cela permis l’essor du christianisme mais également l’agonie du monde romain par la perte de la cohésion, dans une sorte de crise d’identité spirituelle. Celui qui cherche a s’élever est rabaissé chez les chrétiens. Dans le monde moderne c’est le but.
Cela renvoi nécessairement à la morale que vous soulevez entre le bon ceci et le mauvais cela, et le moyen de faire le tri. Car la finalité et l’enjeux n’est pas la technè (le faire), ni l’epistèmè (le savoir), mais du bon usage de la praxis (l’agir).
+0
AlerterSouveraineté du peuple ou du Sénat ? Les deux indivisibles : L’emblème de la république, qu’on trouvait sur les insignes de la légion, c’était SPQR, soit Senatus PopulusQue Romanus – Le Sénat Et le Peuple Romain. je crois qu’ils l’ont gardé au temps de l’Empire.
+0
AlerterBof…parfois les approches les plus simples sont auss les plus parlantes. Res publica, c’est la chose publique. La protestas est censée être exercée SPQR. En vérité l’aristocratie l’a confisquée, mais le plus souvent avec l’appui de telle ou telle partie du peuple…et souvent aussi avec des troupes en partie non romaines,surtout à partir de la fin du premier siècle. En fait rien de vraiment nouveau sous le soleil,n’est ce pas?
+1
AlerterCher Jacques Sapir. C’est toujours un immense plaisir de vous lire.
Étant démocrate, je suis forcément souverainiste Côme vous. Pour autant votre parallèle avec la république romaine souffre de contresens.
Prenons le cas de Cicéron. Vous inversez cause et conséquence. Ce n’est pas parce que Cicéron développa une conception fétichisante de la république dans ses écrits et discours que le peuple a été réifié.
C’est parce qu’il voulait réifier ce qu’il appelait « mala plebs », la vile populace, qu’il a développé ses théories afin de donner un cadre conceptuel à ses intérêts et objectifs politiques et à ceux de sa classe.
Toute l’histoire de Rome, depuis les origines obscures, est celle d’une internationale aristocratique se renforçant des apports des aristocraties étrangères voisines pour conjurer coûte que coûte l’évolution vers une souveraineté populaire.
Relisez la célèbre harangue de Scipion Émilien prenant à partie une assemblée hostile en lui reprochant de n’être que des fils d’affranchis, des adoptés, bref des citoyens de pacotille.
La plupart des politiciens aristocrates qui embrassaient la via popularis ne le faisaient que quelques années, par opportunisme, afin de donner un coup de boost a leur carrière.
Les rares qui étaient sincères et qui se souciaient de ce que nous appellerions l’intérêt général (cf Luciano Canfira : César, le dictateur démocrate) n’en étaient pas moins des aristocrates désireux de dominer et leurs pairs et le peuple qui les soutenait, afin de perpétuer leur pouvoir. D’où leur assassinat.
+1
AlerterLes commentaires sont fermés.